Ali Ghediri à travers ses écrits
La nation est d'abord une mémoire
Point de vue
C'est l'illustration choisie par la rédaction du quotidien El Watan en une de son édition du 20 janvier 2016, pour son article «Campagne contre Zohra Drif et Yacef Saâdi : l'ignoble lynchage», qui a inspiré ma modeste contribution.
Je me suis ainsi retrouvé invité, malgré moi, à un débat qui, quoiqu'on dise, ne saurait laisser aucun Algérien indifférent tant il y va de son histoire. Notre «moi» national ne gît-il pas en son lit ? De quoi pourrions-nous nous prévaloir sans elle ? De nos ressources ? De nos richesses ? De notre modèle socio-politique ? De notre modèle religieux ? De notre (nos) langue(s) ? De la grandeur de nos dirigeants ?
A supposer qu'ils soient meilleurs que tout ce dont peuvent se prévaloir tous les autres peuples, ils demeurent, comme en mathématiques, des conditions nécessaires mais néanmoins insuffisantes. Notre histoire — elle seule — a, n'en déplaise aux uns et aux autres, conféré à ce peuple la dimension manquante. Elle seule l'a élevé au rang de nation.
La nation, dit le philosophe et écrivain Ernest Renan, est «une âme, un principe spirituel (…). La nation est, comme l'individu, l'aboutissement d'un long passé d'efforts, de sacrifices et de dévouements. Le culte des ancêtres est de tous le plus légitimes ; les ancêtres nous ont fait ce que nous sommes. Un passé héroïque, des grands hommes, de la gloire… voilà le capital social sur lequel on assied une idée nationale. Avoir des gloires communes dans le passé, une volonté commune dans le présent ; avoir fait les grandes choses ensemble, vouloir en faire encore, voilà les conditions essentielles pour être un peuple. On aime en proportion des sacrifices qu'on a consentis, des maux qu'on a souffert».
L'histoire nationale est le fait d'hommes et de femmes qui, à l'image de cette adolescente illustrant l'article en question, ont pris leurs responsabilités et bravé la mort pour que cette nation naisse… Ils l'ont faite. Nos repères sont là. Nous existons grâce à eux. Au-delà de nos différences et de l'imperfection de ces hommes et femmes – qui ne sont, somme toute, que des mortels –, nous leur demeurons redevables pour ce socle laissé en legs aux générations présentes et futures, pour cette idée nationale qu'ils ont su nous inculquer.
Pourquoi alors sommes-nous en train de les jeter en pâture, oubliant qu'en agissant ainsi, nous ne faisons, ni plus ni moins, que nous donner en spectacle et offrir aux prédateurs notre histoire en festin ? Est-ce là le serment fait à nos martyrs ? De grâce, arrêtons ce funeste spectacle ! Et, au lieu de vilipender la sénatrice Zohra Drif, observons plutôt cette image d'El Watan et tirons-en les enseignements qui s'imposent à nous en autant de jalons à notre mémoire collective.
Attardons-nous sur cette frêle silhouette, scrutons son regard juvénile plein d'innocence et admirons son courage d'être là, debout, stoïque, bravant la mort pour les actes qu'elle a commis au nom de cette Algérie, pour qu'elle devienne libre et indépendante. Focalisons davantage sur sa bravoure et méditons sur son héroïsme. Admirons sa posture arrogante, mains nues, face à ceux qui l'entourent l'arme au poing… «On aime en proportion des sacrifices qu'on a consentis, des maux qu'on a souffert», avait dit Renan.
Quant aux supputations sur ce qu'auraient pu lui arracher ses tortionnaires comme aveux, demandons-nous, avant de la condamner a posteriori – si tant est qu'elle ait parlé – qu'auraient fait ses détracteurs, à sa place, avec ce physique qui est le sien et à son âge, face aux moyens dont usaient ses bourreaux, les paras de Massu ? La question mérite d'être posée. La raison aurait voulu qu'on laisse d'elle, aux générations futures, cette image par trop expressive où elle incarne, à travers son regard, le défi de cette jeunesse algérienne à l'occupant. Hassiba Ben Bouali, Malika Gaïd et d'autres chahidate étaient ses compagnes.
Disons-nous que si elle avait été exécutée pour l'acte héroïque qu'elle a accompli, nous l'aurions glorifiée autant en toute justice. Sûrement qu'elle aurait aimé faire partie de ce lot de martyrs, mais le destin en a décidé autrement. Elle est restée en vie et ce n'est pas pour autant qu'elle a démérité, à l'instar de tant de moudjahidine et de moudjahidate. Considérant peut-être que – encore Ernest Renan – la République est avant tout un régime politique et que la nation est l'adhésion à un ensemble de valeurs, elle a parlé.
A tort ou à raison, elle a cru qu'en tant que moudjahida, la continuité du combat s'impose à sa génération par devoir et que le silence serait trahison. La conviction a guidé leurs premiers pas dans l'action militante, il serait naïf d'attendre d'eux qu'ils puissent se déjuger au crépuscule de leur existence.
Aussi, quelles que soient la manière et la nature des revendications et des critiques qui pourraient en émaner, autant que leur objet, rien ne justifie, raisonnablement, qu'on puisse recourir à la vindicte et à l'opprobre, encore moins à l'internement pour faire taire ces voix.
Il ne s'agit point pour moi de défendre Zohra Drif ni Yacef Saâdi ou tout autre moudjahid en tant que tel. Précisément, ceux-là, je ne les connais pas et je n'ai pas la prétention de m'ériger en leur avocat, malgré tout le respect que je leur dois en tant qu'aînés. Ils trouveront certainement en leurs frères d'armes d'hier de meilleurs défenseurs. Il s'agit pour moi de défendre «notre histoire» à tous, «notre mémoire», le socle de notre nation dont nous revendiquons le partage.
Cette mémoire devrait être sanctifiée, car elle conditionne notre «être» autant que notre devenir et, à ce titre, elle ne doit, en aucune manière, être sacrifiée sur l'autel des querelles politiciennes du moment ou au nom d'ambitions individuelles ou claniques, affichées ou latentes.
«Avoir des gloires communes dans le passé, une volonté commune dans le présent, avoir fait les grandes choses ensemble, vouloir en faire encore, voilà les conditions essentielles pour être un peuple», avait dit Renan. Si nous voulons nous inscrire dans la trajectoire de la pérennité en tant que nation, préservons son passé et faisons barrage aux prédateurs pour qu'ils ne souillent pas nos mythes fondateurs. Telle est la voie, tel est le prix et tel est le véritable serment.
La Nation et ses militaires
Par Ghediri Ali
L'actualité internationale n'a de cesse, ces derniers temps, de nous interpeller, d'une manière directe ou indirecte, sur la place qu'il conviendrait de donner à l'armée et au rôle à lui assigner au sein de la nation, d'une manière générale, tant les défis sécuritaires présents, de par leur nature, transcendent les moyens traditionnels affectés par les Etats à cet effet. Chez nous, certains discours politiques, autant que certains événements ne sont pas sans placer, tout autant, cette institution au cœur de l'actualité nationale. Quoique les formes diffèrent, le lien causal est présent.
De l'interrogation sur la nature de l'Etat national au traitement dont font l'objet certains officiers remis à la vie civile. Il en est ainsi du cas d'espèce que représente l'internement du général Benhadid Hocine et de sa décision d'observer une grève de la faim. A plus d'un titre et, en toute logique, cette situation n'est pas de nature à laisser indifférent qui que ce soit, civil ou militaire, cadre ou ouvrier. A fortiori, ses camarades, qu'ils soient en activité de service ou à la retraite, qui ont tous en partage certaines valeurs inculquées par le métier des armes et, quoique à des degrés divers, l'obligation de réserve.
Les officiers à la retraite sont certes soumis à cette obligation, mais garder le silence, au moment où un frère d'armes est en train de mourir à petit feu, parce qu'on lui a refusé le droit d'être entendu et jugé comme le stipulent les lois de la République, ne serait-il pas un déni à ces valeurs qu'ils ont fait leurs en tant qu'anciens officiers en faisant de l'honneur et de la solidarité entre frères d'armes la pierre angulaire de leur premier serment ?
Ne devons-nous pas nous rappeler que les officiers, aujourd'hui à la retraite, ont été les actifs d'hier, comme ceux, en activité aujourd'hui, seront les retraités de demain.Telle est la règle universelle qui régit les armées et tel est le destin de ceux qui, par vocation, conviction et engagement ont embrassé la carrière militaire, souvent à un âge où les choix fondamentaux n'étaient pas évidents. Il en est ainsi du général à la retraite Benhadid Hocine qui, à 17 ans, prit son destin en main et, comme tant d'autres moudjahidine et martyrs, est allé rejoindre la valeureuse Armée de libération nationale (ALN). Dans les rangs de son héritière légitime, l'Armée nationale populaire (ANP), il a participé, à l'instar de ses compagnons, à toutes les missions de défense de la Patrie, de lutte contre les hordes intégristes, d'édification nationale et d'éducation des jeunes générations.
Ils ont, avec à leurs côtés les véritables patriotes que compte la Nation, au prix de leur sang et de leur sueur, fidèles au serment qu'ils ont fait à la Patrie, au nom de nos chouhada, fait rempart à tout ce qui était de nature à menacer notre intégrité territoriale, les institutions de la République et les valeurs de Novembre. Il en a été ainsi hier, il est de même aujourd'hui et il en sera ainsi demain. Tel est l'authentique message de Novembre 54 et – une certitude –, ils lui resteront fidèles, advienne que pourra.
Que ceux qui se sont convertis au nationalisme au rabais, profitant du confort que la sécurité désormais retrouvée leur offre, méditent sur ce qu'aurait pu être cette Algérie sans ces hommes, de la trempe de l'interné d'El Harrach et de tant d'autres, qui, par l'humilité et par la décence qu'ils ont érigées en culture – autant dire en état d'être –, ont choisi de faire profil bas et de se taire, laissant faire les amnésiques… Ils se sont tus.
Il s'agit d'une option. Ils ne veulent pas voir leur pays en ruine. Les images de la décennie noire les hantent et celles de la Libye, de la Syrie, du Yémen et de l'Irak, pour ne citer que ceux-là, sont là pour leur rappeler, au quotidien, qu'ils ont fait le bon choix.
Toutefois, face aux voix, qui s'élèvent d'un peu partout, pour vouer aux gémonies, d'une manière systématique et particulière, tout ancien officier qui, d'une manière ou d'une autre, ose faire preuve d'outrecuidance, souvent à bon escient, pour dénoncer un fait, un geste, a fortiori, une politique, leur silence ne peut que prendre les allures d'un manquement à leur propre code d'honneur, voire les contours d'une trahison.
La parole critique, au-delà de ses formes, parfois éthiquement condamnable et de son objectivité relative, ne saurait, quel que soit le motif, admettre autant de vindicte et d'opprobre, encore moins autoriser un usage aussi abusif de la force. Et ce n'est pas parce que le pouvoir politique en dispose en toute légalité qu'il faille aller jusqu'à pousser ses contradicteurs à recourir au suicide, en leur refusant ce que la loi fondamentale de la République leur garantit.
A contrario, à ses thuriféraires, tout est permis, y compris l'insulte de ceux qui ont fait du service de la Nation un sacerdoce. C'est à tort que les premiers soient catalogués ennemis. Ils ne le sont ni ceux du pouvoir, encore moins de la Nation. Il leur arrive tout juste d'exprimer un avis parfois divergent en tant que citoyens, dans les formes qui sont les leurs. Que l'on ne focalise pas sur la manière… L'armée les a ainsi forgés ou, pour faire plus soft… formatés.
A défaut, une question se pose.
L'exercice de la politique serait-il devenu le monopole de ceux qui, pour s'être abreuvés aux auges de la rente, n'ont d'autre choix que de louer les mérites de leurs maîtres du moment ? Ce serait insulter l'intelligence de ces derniers que de croire qu'ils ne sont pas sans savoir que ces laudateurs feront de même, demain, avec les nouveaux arrivants. Telle est leur nature.
L'horizontalité est leur posture, et le jappement leur mode d'expression. Même lorsqu'ils tentent l'ascension, ils empruntent aux reptiles leur mode de locomotion. Rien n'est de trop pour contenter le maître de céans. Le strapontin est leur idéal. Ils sont aux tenants du pouvoir ce que le lierre est au chêne. Pour autant, le pouvoir a-t-il besoin d'abattre tous les chênes pour que, de sa hauteur, il puisse admirer le lierre. Il lui suffit de baisser bien bas les yeux, le parterre en est jonché.
La pensée est par définition dialectique.
D'où qu'elle émane, elle ne saurait ne pas admettre sa mise en débat. Et c'est parce que le peuple l'a revendiquée que la liberté d'expression a été constitutionnellement consacrée. A l'évidence, il ne pouvait en être autrement, s'agissant de descendants de Gaïa, de
Massinissa et de Jugurtha ; d'un peuple qui a enfanté Novembre 54 et d'une Nation enfantée par Novembre 54. Alors, pourquoi s'acharner contre un général qui, somme toute, a dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas ? Est-ce pour faire taire toute la corporation d'officiers retraités ? Lorsqu'on voit la liberté que prennent certains parvenus sur la scène politique nationale pour critiquer et les individus et les institutions, nous sommes en droit d'affirmer qu'il s'agit bel et bien de ça. Pourquoi ce qui est permis aux autres devient subitement illicite lorsqu'il s'agit de cette catégorie de citoyens ? Interrogeons-nous alors sur le sens à donner à la citoyenneté et à leur égalité constitutionnellement consacrée.
En tout état de cause, si l'intention des décideurs est de leur imposer le silence, un seul général, même mort de faim dans sa cellule d'El Harrach, ne saurait atteindre le résultat escompté. Qu'il me soit permis de dire à tous que les officiers de la République, fussent-ils à la retraite, ne sauraient, en aucune manière, être assimilés à un produit marchand politique. Que ceux qui ont fait de la politique un métier, par vocation ou par effraction, sachent que les généraux auxquels ils s'en prennent aujourd'hui ont été là, jeunes officiers, debout, lorsque l'Etat et la République démocratiques vacillaient et, qu'à l'horizon, pointaient le khalifat et le salafisme. Sans eux, et sans le front nationaliste qu'ils ont contribué, dans une large mesure, à fonder avec tous les Patriotes de ce pays, d'aucuns n'auraient pas vécu assez pour pouvoir à présent verser dans leur lexique politique des termes, pour, pensent-t-ils, mieux haranguer les foules qu'ils croient asservies et amnésiques. Il en est ainsi de l'euphémisme «Etat civil».
Est-ce pour ne pas dire «dictature» qu'ils y ont recouru, sachant pertinemment que le peuple est conscient qu'il n'en a jamais été ainsi en Algérie ? Les chouhada d'hier et d'aujourd'hui ne se sont pas sacrifiés pour que l'Algérie indépendante le soit et les moudjahidine qui, depuis le recouvrement de l'indépendance nationale président aux destinées du pays, ne l'auraient jamais permis. Sur un plan théorique, dans la philosophie politique, on n'oppose pas «Etat civil» à «Etat militaire». Pour s'en convaincre, la compulsion de l'œuvre monumentale de John Locke est fort indiquée à ces apprentis politiciens pour que les concepts auxquels ils pourraient avoir recours soient mis à l'endroit.
Que la rente fascine, ceci relève d'une lapalissade, car ce qui est valable chez les autres, l'est aussi chez nous, quoique les formes et les niveaux diffèrent.
Néanmoins, que ceux qui en ont fait une source de revenu et une raison de vivre sachent que son bénéfice induit une contrepartie qui, souvent, n'est d'aucune compatibilité avec les règles les plus élémentaires de la morale, de l'éthique et de la dignité humaine. Qu'ils la pratiquent à leurs aises, mais qu'ils laissent l'Armée Nationale Populaire en dehors de leur champ de prédation. Qu'on ne confonde pas Etat et régime, et armée et milice.
L'Algérie, depuis le recouvrement de son indépendance, n'a jamais autant ressenti le besoin de disposer d'une armée forte et unie.
La préservation de cette institution passe inéluctablement par celle de sa composante humaine – en activité et à la retraite – dont les officiers constituent la colonne vertébrale. C'est en effet vers eux que, lorsque la Nation aura besoin de tous ses fils, que son regard se portera. Inéluctablement, ils répondront présent à son appel, y compris ceux qui, parmi cette cohorte, à l'instar du général Benhadid Hocine, sont privés de leur liberté.
Que la raison l'emporte sur les passions.
Les hommes passent. Nous sommes tous mortels. Aucun cavalier n'a été enterré sur le dos de sa monture, dit le proverbe.
La Nation et ses ennemis
J'ai quelque peu hésité sur le titre à donner à ma présente contribution. Fallait-il parler d'Etat ou de nation ? Au final, dans ce monde qui est le nôtre, où tout se confond, où tout s'entremêle, Etat-nation, pouvoir-régime, parti-clan, pouvoir-opposition, leader-parrain, opposant-ennemi, laudateur-nationaliste, convient-il de s'interroger sur l'usage du scalpel lorsque la hache est de mise ?
Lorsque les hommes se mettent à se confondre avec l'Histoire qui les a faits, lorsque les lois qui régissent la chose publique et la vie en société sont bafouées, lorsque les individus se substituent aux institutions qu'ils sont censés servir, lorsque le vulgum pecus s'érige en tribun et s'arroge le droit de haranguer l'élite, la politique perd de son essence et est échue au rang de «travail», avait postulé H. Arendt dans sa hiérarchisation des activités humaines, considérant que, si le travail permet à l'homme de vivre, c'est dans l'action que s'exerce pleinement sa liberté et que, par son biais, il entre dans le monde politique.
Et, c'est parce qu'agir signifie, au sens large du terme, prendre une initiative, entreprendre, mettre en mouvement, que la politique a ses règles et que sa pratique ne saurait se passer des valeurs censées la caractériser. A défaut, le grain de sable serait en droit de s'ériger en erg, voire d'en revendiquer l'immensité.
C'est dire que, quelles que soient les conditions, les confusions énoncées ne sauraient trouver une quelconque légitimation, car ne s'inscrivant dans aucune logique de gouvernance saine. Néanmoins, en ces temps d'agitation extrême, les raccourcis semblent emporter la mise dans la dynamique sociale et les confusions font désormais office de certitude. Ce faisant, croit-on, sincèrement, que ce peuple est naïf au point de gober tout ce qu'on lui sert ?
Interrogeons l'histoire pour nous rendre compte que ce peuple ne saurait être, en aucune manière, dupe. Si 132 ans de colonisation ne lui ont pas fait oublier ses origines, c'est que son socle identitaire est ferme et solide. Si les hordes fondamentalistes, encouragées et soutenues autant par l'Occident que par l'Orient, n'ont pas pu avoir raison de lui, c'est qu'il sait discerner entre bonnes et mauvaises causes. Si les «printemps arabes» ne l'ont pas entraîné dans leur sillage, ce n'est pas tant par lassitude, comme on s'est précipité pour expliquer sa posture, c'est, fondamentalement, parce qu'il a suffisamment muri.
Que l'on se détrompe, s'il n'est plus sensible aux chants des sirènes — d'où qu'ils viennent —, c'est parce qu'il cultive toujours l'espoir de voir la raison l'emporter sur les passions des acteurs politiques, le souci du devenir de la nation, l'emporter sur les ambitions individuelles. Il s'arme de sagesse et cultive l'espoir, pour que ses jours à venir ne soient pas une éternelle reproduction de son amer passé lointain et récent. Sa vigilance est d'autant plus grande, qu'échaudé par ce qu'il a vécu, par ce qu'il a enduré, il craint que les abus dont il est spectateur — faussement passif, car conscient qu'il y va de son sort et de celui de sa descendance — ne soient exploités par des aventuriers qui usent et abusent de la conjoncture pour étouffer son aspiration au mieux-être et à la démocratie, ignorant, peut-être, que l'adversité rend aux hommes toute la vertu que la prospérité leur enlève.
Pourtant, il suffirait de réexaminer les différentes échéances électorales pour apprécier le degré de maturité politique de ce peuple. Conscient que sa voix importe peu et que les jeux sont faits avec ou sans lui, il a toujours réagi à sa manière, faisant de l'abstention une manière propre à lui d'envoyer ses messages «politiques» aux décideurs. Et, s'il ne maîtrise pas la brasse ou le crawl, il excelle dans la «planche». Lorsqu'il lui arrive, de temps en temps, de s'agiter, c'est juste pour s'éviter la noyade. Telle est sa façon de lutter — avec intelligence — en attendant de voir venir les choses. Il se démène comme il peut pour rester à flot ! Quel grand peuple !
A ce peuple, on devrait s'abstenir de lui montrer ses ennemis. Ses ennemis sont ceux de la nation. Les ennemis de la nation, il les connaît. Il suffit de le lui demander et de daigner l'écouter. Il en est autant de ses héros d'hier comme d'aujourd'hui. Observateur attentif, il se distingue par une avidité, sans limite, de gloire et de victoire. Qu'on scrute ses réactions à chaque fois que l'Armée nationale populaire assène ses coups mortels aux hordes terroristes. Il en tire fierté et exaltation. C'est vrai, dans la grisaille ambiante, la joie et l'allégresse ne peuvent provenir que de cette digne héritière de la glorieuse ALN.
Sur le plan historique, s'il s'identifie volontiers et avec fierté aux «Vingt-deux» et aux «Six», tout en se revendiquant de ses héros numides, c'est qu'il est d'extraction digne. Malgré le temps d'incertitude et de vaches maigres qui caractérise — dans la durée — son quotidien, conscient de son potentiel réel, il demeure à l'affût de tout vent pouvant chatouiller son ego national à défaut de faire claquer son emblème. Qu'on se rappelle Omdurmanet, surtout, qu'on médite sur l'intérêt accordé par notre jeunesse au sacre de Leicester à la tête de la Premier League, au seul motif qu'un certain Ryad Mahrez ait contribué à son succès. A défaut de grives, on mange des merles, dit le dicton.
Vraisemblablement, ce peuple reste incompris par ceux auxquels son destin est dévolu. Il fait malheureusement figure d'immature à leurs yeux. C'est ainsi qu'on assiste à des professions de nationalisme à l'emporte-pièce, où la menace est agitée à tout bout de champ et l'ennemi interne montré du doigt. Il en est ainsi de ceux qui voient en les officiers à la retraite son incarnation !
Qu'ils se rassurent. Le sens de l'honneur est chez ces gens-là tel que, dans leur imaginaire, la représentation qu'ils se font de l'ennemi est qu'il soit toujours debout, armé, prêt à leur ravir leur propre vie. La verticalité est de mise dans leur subconscient. A en juger par la temporalité de l'«attaque» de ceux qui ont décidé de les désigner en tant qu'ennemis de la nation, on est enclin à affirmer que ceux-là, par contre, attendent que leurs sujets soient à terre pour leur crier «haro sur le baudet», que le céphalopode dont ils ont usé des tentacules dans leur ascension politique et sociale, soit hors de l'eau, pour lui cracher à la figure leur venin.
Quel mérite et quelle ingratitude ! Quand bien même l'antagonisme politique soit la forme la plus forte de tout antagonisme, il ne saurait autoriser la haine, celle-ci relève de la sphère individuelle. Si on la ressent en tant que politique, c'est qu'on est primitif. Un homme d'Etat suppose, entre autres, une certaine conscience de l'entité qu'on est censé servir, à savoir une unité qui englobe tous les contraires. Sont-ils conscients qu'ils sont en train de préparer le terreau à l'hostilité au sein-même de la nation ? Ignorent-ils qu'elle est la matrice de la guerre, qui n'est rien d'autre que la négation existentielle de l'autre ? Nous voyons bien qu'il s'agit de deux représentations diamétralement opposées de l'ennemi. A ces officiers, on a toujours appris à ne pas tirer sur les ambulances, encore moins achever les blessés.
On leur a par ailleurs appris qu'endosser la tenue et commander les hommes et agir en lâches relève de l'antinomie. Voyez-vous, le métier des armes est un véritable creuset de valeurs. Ceux qui ont opté pour cette voie ont, dans leur for intérieur, déjà répondu à la question fondamentale de savoir s'il faille servir la nation ou servir ceux qui s'en servent pour se servir ? Car telle est la véritable problématique et telle est la différence entre les serviteurs de la République et les obligés de ceux qui s'en servent.
Lorsqu'on a pour toute idéologie la flatterie et qu'on s'investit éperdument dans la coterie, on devrait, en toute logique, s'interdire de se prévaloir d'une quelconque fidélité, notamment aux principes de novembre, lesquels ont été portés par une élite qui a fait du don de soi un sacerdoce. Les quelques survivants de cette génération racée, qui se démènent encore comme ils le peuvent pour préserver et perpétuer ce qui reste de ces valeurs, devraient être pris en exemple.
Par l'acte. Le discours apologique à leur adresse, ils n'en ont cure. Ils sauront refuser, le moment venu, de servir de promontoire aux invertébrés et à ceux qui se sont inscrits dans la servitude, se complaisant dans le rôle de petites mains que leurs maîtres du moment leur ont assigné. Si tous les gens avaient compris le sens de l'honneur, ils seraient tous devenus honorables, avait dit, si justement, Hafed Ibrahim.
Dieu reconnaîtra les siens, dit-on. Qu'on ne se méprenne pas sur le silence du peuple. Il saura, lorsque l'amplitude du tumulte dépassera celle du verbe flatteur, reconnaître les siens, car il a, de tout temps, dans les moments difficiles, su faire la différence entre le bon grain et l'ivraie.
Par Ghediri Ali
Général-major à la retraite
Le sens des lumières
On m'a expliqué qu'il en est ainsi à chaque fois qu'il y avait un attentat terroriste à travers le monde… occidental, ai-je pensé en mon for intérieur, convaincu que les Occidentaux ne s'émeuvent que pour les leurs ; des autres, ils n'en ont cure. Réaction primaire, somme toute, tant, s'il fallait, rituellement, éteindre les feux de cet illustre monument pour exprimer la sympathie et la compassion de la Franceavec tous les peuples de la terre, les Parisiens se seraient retrouvés déambulant dans le noir, dans la ville des lumières. La rationalité est bel et bien née là-bas… me diriez-vous.
L'Occident peut bien se défendre d'être aussi sélectif en la matière et arguer à l'adresse de ceux qui en doutent, qu'au lendemain de l'attaque au gaz dont ont été victimes, parmi tant d'autres, des enfants syriens, Donald Trump a bel et bien, solennellement, déclaré, après une salve nourrie de Tomahawks sur la Syrie, qu'il l'a fait pour qu'«aucun enfant de Dieu ne devrait jamais subir d'horreur pareille».
Quel geste majestueux de compassion et d'humanisme ! Combien nous aurions aimé entendre ces professions de foi à chaque fois qu'un enfant, quel qu'il soit, tombe, sous quelque bombe que ce soit et où que ce soit. Crédules, que nous sommes ! Souvent enclins à oublier que l'Occident judéo-chrétien — c'est ainsi qu'il se définit — a sa propre logique.
Il se nourrit de sa rationalité. Il sait toujours faire montre de discernement, y compris dans l'expression de ce dont il se prévaut, l'humanisme. Ses sentiments, il les distille au compte-gouttes, toujours à l'aune de sa perception du monde, de ses valeurs et de ses intérêts. Il a sa propre grille de lecture. Sa matrice à lui. Ses chrétiens à lui. Les Coptes d'El-Minyane seraient, somme toute, que des Egyptiens… Où se situe le problème, alors ? Devrait-on se poser la question.
Le problème est bel et bien en nous.
Les massacres, ce sont nos peuples qui les subissent. Ils les vivent dans leur chair désormais fortement meurtrie tant elle est tailladée au quotidien aussi bien par les «frères» que par les autres. Ce martyre, nous le vivons depuis des décennies. S'il est tout à fait dans l'ordre naturel des choses de méditer sur les auteurs de ces crimes et sur les voies et moyens pour nous extirper de cette spirale infernale, il l'est moins, sauf à accepter le ridicule qui en découle, lorsqu'il s'agit d'attendre que les Occidentaux fassent le deuil à notre place. Nous aurions été moins ridicules et, surtout, plus avisés.
Ceci aurait certainement mieux servi notre cause en ce qu'il nous aurait permis de mieux situer nos responsabilités à la fois, en tant que gouvernants autistes et en tant que gouvernés attentistes. Au lieu de nous adonner à cet exercice de mémoire et d'autocritique, nous préférons, hélas, nous lamenter et attendre que l'on nous prenne en pitié, en éteignant un lampion ou en «regrettant» ce dommage, lequel, central ou latéral, est toujours vécu dans la même chair, la nôtre.
Ce faisant, nous avons, peut-être, cédé à un élément singulier de notre culture. Car, en matière de lamentations, quoique nous ne disposons pas de mur pour y déverser nos larmes et y enfuir nos vœux, à l'instar d'autres peuples, notre patrimoine culturel peut s'enorgueillir — si je ne m'abuse — d'être le seul à jouir d'un genre littéraire E'ritha, poésie exclusivement dédiée aux morts, pour en vanter les mérites et nous faire bonne conscience. C'est dire, qu'en la matière, nous nous y connaissons…
Les poèmes d'El Khansa', de par la beauté de la langue dans laquelle ils ont été écrits et la force du verbe choisi pour exprimer la douleur ressentie, peuvent fortement nous inspirer, si, tant est que cela puisse soulager ce ressentiment d'impuissance dans lequel nous trouvons… Chez nous, nos aïeux étaient plus avisés en ce qu'ils ont compris qu'il ne faille compter que sur soi pour changer l'ordre des choses. Ne dit-on pas qu'«il n'y a pas mieux que tes cils pour supporter tes larmes et que tes ongles pour égratigner tes joues»… Alors, pourquoi s'acharne-t-on encore à en vouloir à l'Occident de n'éteindre ses lumières que pour déplorer ses morts et pas les nôtres ?
Par ailleurs, s'il fallait exiger des Occidentaux de compatir à notre douleur en éteignant leurs lumières comme ils le font par égard aux leurs, à chaque fois qu'un massacre est perpétré, suite à un attentat terroriste ou à un «dommage collatéral», survenant en Syrie, en Irak, en terre de Palestine, à Ghaza ou à Ramallah, au Yémen, en Libye, en Egypte, en Somalie, au Pakistan, en Afghanistan, au Nigeria, au Maliou dans tout autre pays arabe ou musulman, la Tour Eiffel se serait retrouvée drapée, le soir venu, depuis plus de deux décennies, dans le noir ! Et, s'il fallait aller plus loin dans l'extrapolation ? Si tous les pays occidentaux devaient suivre l'exemple français, pour éteindre, qui sa tour, qui son palais, qui… quoi … ?
Nous aurons été les porteurs de ténèbres, en ces temps, alors que nos aïeux ont été, naguère en terre d'Occident, les porteurs de Lumières. On ne pourra pas avancer, les yeux rivés continuellement sur les rétroviseurs, m'objecterait-on… J'en conviens ! Mais, lorsque les ténèbres meublent notre espace et que le désespoir s'impose en sentiment partagé, les rais de lumière font figure de phares, dusse-t-on aller les chercher dans les entrailles de l'histoire.
En toute logique, il ne pourrait nous venir à l'esprit d'exiger de l'Occident d'être magnanime à l'égard de nos morts et de compatir au sort de nos peuples comme ils le font pour les leurs. Si, nous-mêmes, nous demeurons insensibles au désarroi et aux malheurs de nos peuples ; si, nous-mêmes, nous ne ressentons pas les brûlures de la braise sur laquelle notre pied est posé, que sommes-nous en droit d'attendre des autres ? Encore moins, d'en exiger ?
Cette passivité à l'égard de nos malheurs est devenue telle que nos territoires sont devenus un champ d'expérimentation aux armes les plus sophistiquées, les plus meurtrières et les plus destructrices. Il en est ainsi en Irak, en Syrie, au Yémen et en Afghanistan, où la bombe «conventionnelle» la plus puissante, pour des raisons de politique étasunienne interne, vient d'être expérimentée… Sans commentaires, encore moins de condamnations… Il ne peut s'agir, de toute évidence, que d'un silence complice qui en dit long sur l'état de déliquescence dans lequel le monde arabo-musulman est empêtré. Ses peuples font désormais figure de cobayes, sans que cela n'émeuve qui que ce soit, y compris — ou plutôt, notamment — ses propres dirigeants.
Assuré de leur silence, l'Occident les brave au quotidien, sachant, qu'au pire, ils n'auront de cesse de lui signer des chèques couvrant des centaines de milliards de dollars pour qu'ils puissent continuer, en toute impunité, à mieux asservir leurs peuples et à disposer des richesses que leur offre leur sous-sol si riche, pour pérenniser leurs régimes. Plus loin, en Asie du Sud-Est, la Corée du Nord, quant à elle, continue à braver, en toute impunité, la toute puissante Amérique…
Ce parallèle, que la chronologie des événements nous impose depuis la salve de Tomahawks américains sur la Syrie et celle des missiles balistiques que Pyongyanglance à titre d'essai sans trop se soucier de l'ire étasunienne, si incongru serait-il au regard des uns et des autres tant l'idéologie dominante a formaté les esprits, n'invite pas moins à méditer sur deux acceptions de la puissance et de l'ennemi, celle des régimes arabo-musulmans, et celle des autres Etats, telle que — à titre illustratif — la Corée du Nord.
La politique désigne une certaine stratégie, c'est-à-dire une ordonnance particulière de moyens en vue d'une fin. Leur ennemi dûment identifié, les Nord-Coréens ont tiré les enseignements de leur histoire nationale et de l'histoire universelle, et partant, ils ont mis en place une stratégie de survie, voire de pérennisation de ce qu'ils considèrent comme le système qui réponde le mieux à leurs aspirations en tant que peuple. Notre débat ne porte pas sur le bien-fondé de leurs convictions, mais plutôt sur leur démarche. Ainsi, de la première, ils ont conclu que les nations se font dos aux crises et que la puissance n'a de sens qu'à travers son expression, c'est-à-dire l'usage qu'on en fait.
Forts de ces postulats, ils se sont attelés à développer leur outil de défense auquel ils se sont adossés pour édifier et consolider leur système sociopolitique qui, quoi qu'on dise, se fait respecter, à défaut de se faire aimer. De la seconde, c'est-à-dire de l'histoire universelle, notamment après l'éclatement du bloc de l'Est, ils sont arrivés à la conviction que sans une force dissuasive conséquente en propre, il leur adviendra, tôt ou tard, ce qu'est advenu à la République démocratique d'Allemagne.
Ils seront absorbés par leur frères ennemis du Sud et cesseraient alors d'exister en tant qu'entité géopolitique… Ils ont décidé que cela ne leur adviendra pas, et ils agissent en conséquence. Le corollaire de l'efficience de la puissance est l'usage raisonné du potentiel dont elle émane. Ce potentiel, c'est de l'acharnement de l'ennemi dûment désigné et de la volonté d'être qu'il se nourrit. Ne serait-ce qu'en cela, il est inépuisable.
Pour les régimes arabes, notamment, l'ennemi est soit le pays «frère» voisin, soit le parti politique opposant, agréé souvent beaucoup plus par mimétisme des démocraties occidentales — ou sous leur pression — que par une réelle volonté d'ouverture démocratique, si ce n'est leur intelligentsia nationale, qu'ils n'ont de cesse à œuvrer pour la réduire au silence, lorsqu'elle n'est pas carrément poussée au départ.
Dans ces pays, il en est ainsi, malheureusement, jusqu'aux organisations terroristes qui en émanent, en ce que certains parmi eux les financent, entraînent, arment et abreuvent de leur idéologie humainement destructrice. N'a-t-on pas vu, en effet, l'organisation terroriste islamiste Daech s'excuser auprès d'Israël d'avoir, par inadvertance, tiré quelques obus de mortier sur les hauteurs du Golan syrien occupé..?
Israël ne constituant une menace ni pour les terroristes ni pour les trônes, il ne saurait incarner l'ennemi… Encore moins, l'Occident protecteur ! Je ne prétends point dans cette modeste contribution donner une solution à ce drame qui est le nôtre en tant qu'ensemble culturel et géopolitique. Il me semble toutefois indécent d'accabler les autres pour nos malheurs ou pour leur indifférence à notre égard lorsque nous les vivons.
Ceci constitue, on ne peut plus, une forme de fuite en avant tant la responsabilité de tout ce qui nous arrive nous incombe en premier. Nous sommes les artisans de nos propres déboires et de notre arriération multidimensionnelle, scientifique, technologique, culturelle, sociale et politique. Et, si nous vivons mal nos indépendances nationales, c'est que, quelque part, nous ressentons un déficit de liberté que seule la démocratie est à même d'offrir. Que l'on se détrompe. L'unique rempart pour préserver notre dignité et nos peuples de tant d'affres n'est pas atomique, il est démocratique. Contre le rempart démocratique, l'ennemi extérieur est impuissant et l'ennemi intérieur, ne pouvant plus être instrumentalisé, ne peut que perdre de sa pertinence.
Il s'agit là d'un constat sur le degré de déliquescence du corps social arabo-musulman en général et arabe en particulier, lequel, meurtri par un déficit désormais chronique de confiance entre gouvernants et gouvernés, n'a de cesse de trouver en les seules lamentations et en la violence un recours. Ceci ne saurait être, à terme, sans danger. Nous sommes en train de vivre les prémices d'une crise aux dimensions insoupçonnées tant, pour paraphraser le philosophe, «en haut, on ne peut plus convaincre et en bas, on ne peut plus accepter».
De l'abstentionnisme actif
Les Algériens ont avant, et peut-être plus que tous les autres pays du monde arabe, voire musulman, pris le chemin des urnes. Ils l'ont fait bien avant l'indépendance. Ils l'ont fait femmes et hommes, affiliés au collège indigène ou citoyens à part entière.
C'est dire qu'en la matière, notre expérience est appréciable… Pourtant, depuis un certain temps, les joutes électorales, quelles qu'elles soient, ne nous emballent plus, tant le niveau d'indifférence de la population à leur égard, aussi bien lors des campagnes que par l'acte de voter lui-même est on ne peut plus patent.
En témoignent les taux d'abstention aux élections législatives, non pas ceux avancés par l'opposition, mais bien ceux annoncés par le Conseil constitutionnel, lesquels, depuis 2002, caracolent au-dessus de 50% pour culminer en 2017 à plus de 70% (votes blancs et bulletins nuls inclus), s'érigeant ainsi en une réelle tendance lourde dont il serait hasardeux de ne pas en prendre la mesure, ne serait-ce que sur le plan de la représentativité.
Cette abstention, qui consacre dans un certaine mesure une rupture entre un pays réel et un pays virtuel, n'est pas sans porter en son sein les germes d'une recomposition déjà entamée du paysage politique, que le pouvoir va devoir subir à défaut d'avoir pu, ou su, la susciter. Il est en effet dans l'histoire de toute nation de ces soubresauts qui résonnent comme des appels à une renaissance dans l'ordre, pour autant que l'intelligence politique s'en saisisse. De telles opportunités historiques, le Mouvement national a su les faire siennes pour inverser le cours de l'histoire dans le sens qu'il lui a imposé.
Pareille réaction ne saurait être assimilée à un caprice démocratique comme on en voit dans les pays occidentaux. En la matière, le parallèle relève d'une vision autant étriquée que partiale des choses, tant la notion de citoyenneté, de part et d'autre, est autrement appréhendée et les prismes de la pensée politique au niveau populaire sont différents.
Pour notre cas d'espèce, il s'agit bien d'un véritable mouvement qui ne devrait laisser, en toute logique, indifférent tout observateur de la scène politique nationale, a fortiori ceux qui président au destin de ce pays, tant est qu'il était notamment attendu des dernières élections d'être, à la faveur de la nouvelle Constitution, les joutes du renouveau démocratique. Force est de constater que ce ne fut pas le cas.
Pareille posture est en soi révélatrice, si ce n'est d'un mépris manifeste du peuple de la chose politique telle qu'elle lui est servie, de l'existence de contradictions majeures qui agitent la société et la «travaillent» en profondeur. Ceci ne saurait, de par sa nature, quel que soit le système électoral en place, ne pas interpeller au plus haut niveau les pouvoirs publics et la classe politique dans son ensemble. Cette interpellation prend une signification toute particulière dans un système électoral tel que le nôtre, où le rapport entre l'électeur et l'élu est direct, voire personnalisé, où la dimension morale prédomine plus que partout ailleurs.
Partant de ces considérations, on peut estimer que cette abstention, de par son ampleur, est davantage à appréhender comme une forme ostensible de désistement collectif réfléchi d'un droit citoyen fondamental, constitutionnellement consacré. Il suffit pour s'en convaincre d'accorder l'attention qu'il mérite au contenu des réseaux sociaux pendant la dernière campagne pour y percevoir les signes objectifs d'un abstentionnisme actif, voire militant, qui n'est pas sans dénoter une attitude collective consciente et concertée.
Sauf à être inconscient et faire preuve d'irresponsabilité manifeste, tant d'indices devraient, en toute logique, inviter à une réflexion profonde sur les tenants et les aboutissants d'un pareil comportement aussi manifestement négatif et potentiellement porteur de signes avant-coureurs qui ne prêtent en aucune manière à l'optimisme. En effet, pareille attitude ne saurait ne pas présager l'existence d'un malaise, si ce n'est, plus grave encore, d'une forme de désapprobation et de rejet populaires autant de la classe que de l'action politiques en tant que telles, dont il conviendrait de rechercher les causes, car il y a potentiellement péril en la demeure.
Et, si la raison ne peut pas rendre raison de tout, elle le fait objectivement lorsqu'il s'agit de répondre à des questionnements inhérents à des comportements sociaux de masse conscients et réfléchis, pour autant qu'on se donne la peine de faire l'effort de transcender le carcan hermétique dans lequel, souvent, nous enferment nos propres certitudes. Le fil d'Ariane dans pareils cas, c'est l'histoire qui nous le tend…
Le pouvoir politique, sûr de lui et fort de ses hypothèses, a opéré des choix pour engager ses réformes avec une opiniâtreté et un caractère d'évidence, tant à leur bien-fondé qu'au processus devant aboutir à leur application qui n'admettaient aucune mise en cause. C'est ainsi que l'homologation de nouveaux partis politiques, présentée par ses initiateurs comme un gage de bonne foi du pouvoir et une réponse à des revendications prétendument citoyennes, est, sur le terrain de la réalité, appréhendée par une population dubitative, parce que fortement désabusée, et par une opinion par trop vindicative, parce que produit de son histoire, comme une forme de légalisation administrative d'associations sans ancrage tangible dans la société, perçues beaucoup plus comme des greffons à la société que comme de véritables relais politiques potentiellement capables de contribuer à l'émergence d'une réelle citoyenneté.
Une attitude similaire est à attendre à l'égard de tous les textes consubstantiels à la nouvelle Constitution. Pourtant, le pouvoir n'est pas sans savoir qu'aussi bien la consécration que la crédibilité de toute démarche politique, a fortiori réformatrice et se voulant démocratique, sont intimement liées à la nature même du processus de décision, dont les élections constituent l'un des principaux maillons, si ce n'est le principal.
Et, c'est par rapport à ces manquements anodins, d'apparence, que la défiance s'installe, car, en dernière instance, les peuples jugent davantage sur les actes que sur les intentions, les promesses et les professions de bonne foi des gouvernants et de leurs affidés. C'est parce qu'une réforme politique de cette envergure n'est potentiellement pas sans engendrer des conséquences substantielles sur le fonctionnement institutionnel et susciter des réactions et des comportements allant de l'adhésion totale à l'opposition frontale avec tout le spectre de positionnements intermédiaires, que ses initiateurs, au stade même de son élaboration, doivent veiller à sa cohérence d'ensemble.
Car, en règle générale, plus elle est cohérente, moins d'incongruités elle renferme et, partant, moins de réactions de rejet elle crée et, inversement. Il est ici d'une règle de droit constitutionnel se dégageant de l'action politique, étant entendu que tout système politique est sous-tendu par d'authentiques règles de droit dont la Loi fondamentale a vocation à en être la meilleure des expressions.
Par ailleurs, dès lors que toute démarche politique se nourrit des intentions de ses initiateurs, l'indifférence affichée par la population à l'égard de ces élections qui est, le moins qu'on puisse dire, l'expression manifeste de sa défiance par rapport au pouvoir politique — ou à ce qui en fait office — est à appréhender comme étant leur propre échec. Il serait, à mon avis, inhérent, entre autres, au modus operandi que ce pouvoir a choisi pour « réformer » le système et impulser une nouvelle dynamique à la société.
Aux lieu et place d'un débat politique réel, global et inclusif, il a opté, en termes d'ingénierie politico-institutionnelle, pour un débat fractionné dans le choix des interlocuteurs et segmenté dans la thématique. A l'évidence, ceci ne pouvait susciter, au minimum, que circonspection et défiance par rapport à ce qui en était attendu : s'agissait-il de la survie du régime en tant que tel ou du devenir de la nation et des perspectives de son évolution à court, moyen et long termes ? La réponse à l'abstentionnisme est à rechercher dans ce sillage, tant le gap communicationnel et générationnel entre les deux pôles que sont le consultant et le consulté est important.
Comment pouvait-il, en effet, en être autrement face à une génération abreuvée au discours dénonciateur, legs d'octobre 1988, et à une population marquée au fer rouge par les stigmates des années de violence que lui a imposés, sans la convaincre, encore moins la soumettre, l'islamisme radical ? Il aurait fallu en faire, en toute intelligence politique, un partenaire car, lorsque telle est la nature des rapports, la confiance prime sur tout le reste.
A contrario, on persiste à voir en ces strates générationnelles, pourtant démographiquement majoritaires, des mineurs immatures, et à se considérer investi, à leur égard, par l'histoire, du mandat de tuteur éternel. C'est de ces postulats, aux contours paternalistes, que le discours débité tire son essence et, à ce titre, il n'est pas sans porter en son sein les éléments objectifs de son rejet par une population qui lui est désormais, tout simplement, insensible.
Il ne peut en être autrement, tant les slogans scandés sonnent faux, notamment aux oreilles d'une jeunesse dont le pouvoir ne se rend pas compte qu'elle lui tourne le dos, arc-boutée qu'elle est sur elle-même, davantage préoccupée par ses propres problèmes et, surtout, totalement investie dans le développement de son propre langage, de ses propres codes et de ses propres réseaux de communication qui n'ont de virtuel que l'appréhension de ceux qui n'arrivent pas à en saisir ni le sens ni la portée, encore moins le potentiel autant mobilisateur que dévastateur qui est le leur.
On aurait eu raison d'ignorer cette jeunesse et laisser le fossé entre elle et les gouvernants s'élargir si elle ne représentait pas la majorité écrasante de ce peuple. Aussi, serait-il dangereux de la laisser livrée à elle-même, suivant sa propre trajectoire, car il y va de notre devenir à tous. S'il fallait chercher les preuves de cette posture de dos-à-dos qui est celle du pouvoir d'un côté et de la jeunesse de l'autre, l'analyse du contenu de ce que ces réseaux sociaux offrent est on ne peut plus édifiante.
Et, s'il en fallait une autre, les résultats des dernières élections illustrent on ne peut mieux cette figure de trajectoires de deux mondes parallèles qui, bien que partageant le même espace, ne sont pas sans progresser dans deux sens opposés, s'ignorant l'un l'autre, où chacun bat la mesure qui ne fait avancer que les cohortes qu'elle «emballe».
Le clivage n'est plus entre les «nationalistes» et les «autres», comme semble le laisser transparaître le discours des partis se prévalant de la majorité, mais entre tous les «encartés», tous partis confondus, et la véritable majorité, celle des abstentionnistes, que les chiffres officiels annoncés par le Conseil constitutionnel créditent d'être représentative de pas moins de sept citoyens sur dix !
Sauf à être autiste, car sourd on répond à la gestuelle, il y a matière à voir en cela, non seulement l'expression d'une véritable déchirure dans le corps social, mais, surtout, les prodromes d'un réel désir de changement — plutôt de rupture — revêtant les allures d'une revendication pour une véritable refondation républicaine. Que les mots ne nous fassent pas peur ! Il s'agit tout simplement d'adapter la politique pour la mettre en phase avec son temps et la rendre plus attrayante pour cette majorité, pour un temps, encore silencieuse.
Somme toute, le changement et l'adaptation, dès lors qu'ils répondent à une demande populaire, fût-elle de la minorité, sont les règles fondamentales de toute gouvernance se prévalant d'essence démocratique. Cette aspiration, indéniablement légitime d'un peuple qui continue à voir, plus d'un demi-siècle après le recouvrement de son indépendance, son sang encore couler, ne saurait être, en aucune manière, appréhendée, sauf à être adepte du statu quo et de la stagnation mortifère, autrement que comme un signe révélateur de la vitalité de son corps social.
Et, c'est parce qu'en démocratie, l'indifférence est péché et son entretien est porteur de périls, qu'elle dispose, en tant que système, d'outils à même d'assurer à tout un chacun le sentiment de son existence en tant que citoyen en lui offrant les voies et les moyens pour faire part de son point de vue sur les problèmes inhérents à la gestion de la Cité. Parmi ces outils, les élections font figure de matrice principale de par leur régularité temporelle et le consensus qui les entoure quant à leur fiabilité pour garantir les transitions politiques pacifiques, pour autant que les règles d'éthique et de transparence et la loi, censées les régir, soient respectées.
A défaut, ce que confirme le corps entier de l'histoire, elles n'ont de cesse de se pervertir en alibi pour perpétuer des situations de rente politique dont, souvent, seul le pouvoir en place use et abuse, jusqu'à s'isoler irrémédiablement du peuple, avec toutes les conséquences qui peuvent découler d'une telle situation, pouvant aller jusqu'à l'effacement de l'Etat. Montesquieu avait, en son temps, déjà averti que «lorsque dans un gouvernement populaire les lois ont cessé d'être exécutées, comme cela ne peut venir que de la corruption de la république, l'Etat est déjà perdu».
En démocratie, quel que soit le système électoral en place, il doit répondre en premier à ce qu'il en est politiquement attendu par le pouvoir constitué qu'incarne le peuple… Il était attendu de ces élections de nous aider à nous entendre entre nous Algériens, à abattre le mur de la méfiance entre gouvernants et gouvernés, à rétablir la confiance entre les générations pour une meilleure synergie des actions et une transition politique en douceur, à contribuer à nous sortir de l'impasse économique, sociale et surtout politique, aux allures crisogènes, dans laquelle nous nous trouvions.
Force est toutefois de constater qu'en l'état actuel des choses, de tout cela il n'en est rien. Bien au contraire, elles nous engouffrent dans une autre impasse aux dimensions historiques. Pessimiste, me diriez-vous ? Je ne demande qu'à être démenti par cette même histoire, pour le bien-être de mon pays.
Un général à la retraite répond à Boukrouh
Général-major à la retraite
Dans sa dernière contribution parue sur les réseaux sociaux, sous le titre «L'armée algérienne : une muette qui ne veut rien entendre», monsieur Boukrouh Nouredine s'est permis certaines digressions qui ne sauraient laisser indifférent plus d'un, tant le contenu contraste avec l'intitulé. J'ai estimé qu'il fallait lui répondre sur certains points qui me concernent es-qualité. Qu'il n'y trouve pas sujet à polémique, car tel n'est pas mon dessein. L'essentiel étant ailleurs.
Monsieur Boukrouh. J'ai toujours lu avec une attention et une assiduité particulières vos contributions. C'est plaisant de vous lire. La succulence des sujets que vous abordez n'a d'égale que la beauté du verbe dont vous maîtrisez si bien le maniement. Succulents, vos thèmes le sont, parce qu'il nous importe, en tant que citoyens, de constater que nous ne sommes pas les seuls à ressentir, impuissants — autant que vous —, les meurtrissures que ce pays, pour lequel autant de sacrifices ont été consentis, endure.
Voyez-vous, le sentiment de partage est en soi réconfortant. Il l'est en ce sens qu'on se surprend à croire profondément que, quelque part, tant qu'il existe des Algériens qui ont cette Algérie chevillée au corps et qui, plus est, l'expriment aussi vaillamment et en de si «belles lettres», comme vous le faites, nous sommes en droit de nourrir de bons espoirs pour ce pays. Somme toute, si abrupte la pente soit-elle, sa remontée, ensemble, la main dans la main, est à notre portée...
Je vous lis, monsieur Boukrouh, et je ne suis pas sans suivre la trajectoire de votre pensée où j'y perçois beaucoup d'amertume et d'inquiétude par rapport à l'état de notre pays et à son devenir. Je partage avec vous ces sentiments et je ne suis pas le seul à le faire. Je peux même, sans grand risque de me tromper, que c'est ce que ressent la majorité écrasante du peuple, y compris ceux que vous avez qualifiés dans votre contribution de déserteurs de la scène publique et de lâches en précisant toutefois, à qui veut l'entendre, que c'est aux «ex-ceci cela» que vous vous adressez. De ceux-là, je fais partie et je vous réponds en tant que tel. Les «autres» sont assez puissants et qualifiés pour vous répondre à leur manière.
Décidément, dans notre pays, il est devenu une habitude, voire de bon aloi, de tirer de tout feu sur les «ex-ceci cela». J'ai eu à dénoncer par le passé, à travers les colonnes de ce même journal, cette tendance qui se profilait déjà, lorsque ceux qui, après avoir bu le calice jusqu'à la lie et tiré toute la volupté que procure le compagnonnage des désormais ex., rien que pour s'en démarquer et se rapprocher du maître de céans, se sont mis à mordre la main qui a étanché leur soif. A vous, qui semblez si friand d'adages du terroir, je résume la chose par «Ekh ya maâza, ma fik hlib» (va-t'en chèvre, tu ne donnes plus de lait). Il m'est difficile — et je m'interdis — de vous aligner parmi cette vermine parce que, ne serait-ce que sur le plan intellectuel, vous les surclassez.
Néanmoins, traiter de lâches ces «ex-ceci cela», c'est non seulement aller vite en besogne, mais c'est faire preuve d'incorrection et de méconnaissance de la réalité nationale, voire de malhonnêteté intellectuelle. Et ce serait insulter votre intelligence que de vous rappeler que par la force de la loi dont vous avez évoqué la promulgation, ces «ex-ceci cela» ne sont plus des citoyens à part entière dans cette Algérie du XXIe siècle... Vous, vous l'êtes. Le droit de s'exprimer sur la chose publique leur est désormais interdit, au risque de poursuites pénales... Malgré cela, ils continuent à dénoncer ce qu'ils considèrent attentant à ce pays et à son peuple. Ils le font publiquement, ici, en Algérie, à Alger. Ne croyez surtout pas, Si Nouredine, qu'ils n'en payent pas le prix ! Ils le payent chèrement. Y compris leur progéniture et leur famille y passent. Vous, monsieur Boukrouh, qui ne courez pas ce risque, osez ! Sacrifiez vos enfants et vos proches comme nous le faisons et traitez-nous par la suite de lâches, ou plus, si ça vous chante ! Ces «ex-ceci cela», s'ils tenaient à leur confort matériel, comme vous les accusez, ils auraient agi comme tant d'autres.
Et, contrairement à ce dont vous semblez être convaincu, ils ne se sont pas enrichis, ils vivent de leur pension de retraite pour la plupart. Ils vivent ici dans leur bled, citoyens, parmi leur peuple, leur «ghachi» avec lequel ils se confondent, et dont ils partagent le bonheur, les vicissitudes et les inquiétudes. Ils vivent avec la certitude du devoir accompli après avoir assumé leur rôle d'élite, dignement, sans tapage, avec responsabilité, refusant la platitude et l'asservissement. Ils n'ont fait allégeance à personne.
Leur seul crime est d'avoir refusé de faire partie de l'orchestre jouant la symphonie des louanges qui n'a d'autre fin que celle de faire mouvoir le bal des ego. Que ceux qui n'ont de cesse d'accorder leurs instruments pour jouer la bonne partition n'y aillent pas de main morte dans ce monde de paillettes où l'apparat l'emporte sur la consistance. Et, si tel est leur choix, nous ne pouvons que le respecter. Qu'ils y excellent et que grand bien leur fasse. Quant aux autres, ces «ex-ceci cela», s'ils ne l'ont pas fait, c'est par conviction. Car telle est l'expression de leur honneur militaire, de leur courage de soldat, de leur dévouement à la patrie et de leur conscience nationale que vous semblez ne percevoir que par la négation. Ne serait-ce que par égard à une aussi noble posture, ils ne méritent pas qu'on attente aussi violemment à leur dignité. Les mots sont porteurs de sens.
Décidément, la sagesse semble avoir pris la terrible décision de déserter nos contrées. Tournant le dos à la nation, elle l'a laissée livrée au désarroi et au désespoir... Désemparées, les masses succombent facilement dans la crédulité. Désormais, on leur fait tout admettre. C'est ainsi que l'envers se substitue à l'endroit, le pire au meilleur et la subsistance à la vie. Et, dans pareil décor, que l'on ne s'étonne pas de voir que les héros d'hier soient traités de lâches !
Monsieur Boukrouh, les «ex-ceci cela» ne sont pas les «suppôts» du pouvoir. Ils ne sauraient l'être pour les raisons objectives, qu'en tant qu'ex-président d'un parti politique et ex-ministre sous ce même régime, vous ne pouvez prétendre les ignorer. Vous voyez, monsieur l'ex-ministre, de ce pouvoir que vous n'avez de cesse de décrier, qu'en matière d'«ex-», vous faites partie du lot de l'infamie. Pourtant, personne n'a osé vous traiter de lâche. Réfléchissez à la question. Peut-être que le champ de la lâcheté n'est pas celui que vous avez désigné dans votre écrit.
Ce n'est sûrement pas à un homme de votre trempe que je vais faire un descriptif du pouvoir. Vous en avez fait partie. Aussi n'êtes-vous pas sans ignorer que le régime, s'il survit, ce n'est pas tant parce qu'il est porté par une base populaire majoritaire, encore moins par la fidélité sans faille de ceux qui se prévalent d'en être les partisans inconditionnels, mais davantage par l'esprit de servilité qui anime ces derniers, mus qu'ils sont par l'appât que constitue la rente dont le pouvoir seul détient les cordons.
Somme toute, ils n'en sont qu'une excroissance, des pseudopodes sans d'autres horizons que celui qui les maintient en vie. Laudateurs, leur hauteur de vue ne peut dépasser la taille du rocher vivier... celle de leur maître du moment. Ils l'érigent en leur source d'inspiration. Ils épousent les contours de son discours, veillant toujours à l'amplifier sans se soucier de sa consistance. C'est le terreau par excellence d'où ils puisent leurs idées pour embellir davantage leurs propres discours forcément flatteurs, monoproduction vivrière de leur terre stérile.
Quant à l'ANP, j'aurais aimé ne pas en parler. Elle a ses tuteurs, que vous semblez avoir pris grand soin à ménager, préférant vous attaquer aux ex-. Mais, si j'en parle, c'est parce que vous avez lié sa puissance aux seuls aspects technologiques. C'est donc sur un plan strictement technique que je vais aborder le sujet. J'y ai passé quarante-deux années de ma vie. Pour y avoir passé vingt-six mois et avec le background intellectuel qui est le vôtre, vous n'êtes sûrement pas sans savoir que toute armée nationale est une institution et, en tant que telle, elle repose sur un socle de valeurs.
Celles dont se prévaut l'ANP sont les valeurs que la glorieuse ALN lui a laissées en legs. Elle les a faites siennes. Et ce n'est nullement un hasard qu'elles aient été sanctifiées par le statut général des personnels militaires. Il s'agissait, dans l'esprit de ses initiateurs, de consacrer statutairement une fidélité aux idéaux de la grande Révolution de Novembre. Sans être exhaustif, j'en cite les plus déterminantes tels que l'esprit de sacrifice, l'abnégation, le don de soi et le désintéressement matériel.
Ce sont les valeurs qui par leur caractère mobilisateur amplifient les déterminations des individus et des groupes sociaux. Elles leur font transcender leur faiblesse, y compris d'ordre technologique. Grâce à elles, les nations, dont la nôtre, se sont libérées et qui, une fois l'indépendance acquise, ont servi de ferment à leur développement économique et à leur évolution sociale. La technologie n'est qu'un moyen que la volonté des nations d'aller de l'avant finit, nonobstant les difficultés, par maîtriser. Les exemples à travers la planète sont légion. Quant à l'usage qu'on en fait, ceci relève d'une autre problématique. Il en est autant d'ailleurs des peuples.
«Les choses qui vont sans dire allant mieux en les disant», aviez-vous postulé dès l'entame de votre contribution, avant d'appeler que des voix fortes appellent à la sagesse et à la conscience patriotique des responsables. Le ton dont vous usez pour vous adresser à ces derniers contraste singulièrement avec celui auquel ont eu droit les «ex-ceci cela», quoique les premiers, en toute logique, sont plus à même de mériter votre ire pour leurs manquements à l'égard de l'Etat, de la nation et de l'Etat-nation qui pâtissent dangereusement de leur mode de gouvernance, que vous n'avez d'ailleurs de cesse de dénoncer.
Il s'agit de toute évidence d'un recul, tactique ou stratégique, c'est selon votre trajectoire. Je vous l'accorde. Il est plus aisé de tirer à boulets rouges sur des ex- que sur les maîtres du moment. Où est l'honneur et où est le courage dont vous avez pourtant dénoncé l'absence chez les ex- ? Tel est mon constat. Je vous le livre tel que je le ressens.
Quant à votre appel devant émaner «min djiblina wa min soudourina», à mon avis, l'Algérie, contrairement au Nouveau Monde et à d'autres contrées, n'est le fait ni d'explorateurs, ni de pionniers, ni de quelque responsable vivant si vaillant soit-il. Son peuple n'a pas jailli ex-nihilo. Il était là sur cette terre, sa mère nourricière, la cultivant, la travaillant et la défendant lorsque l'étranger voulait la lui ravir. Il l'a abreuvée, depuis Gaïa, de son sang.
Du sang, elle en regorge. Elle est le fait d'une lutte continue d'un peuple pour sa liberté. C'est précisément cette continuité qui a forgé en lui cette humeur collective que Germaine Tillion, dans une approche comparative avec nos voisins maghrébins, qualifie d'extrêmement revendicative et peu portée à l'abdication. Autrement dit, cet esprit de résistance, ce germe de rébellion qu'il porte en lui et qui, tel un gène, est transmis de génération en génération. Cet esprit de vaillance et de rébellion n'est pas sans forcer l'admiration des autres à notre égard, nonobstant nos défauts. Pour ma part, je reste persuadé que c'est cet esprit qui prévaudra lorsque l'heure des grands choix sonnera.
Ceci étant, s'il fallait qualifier quelque groupe social de lâche, l'attribut aurait convenu davantage à toute une génération — la vôtre, la mienne — qui n'a pas su — ou pu — assumer le rôle historique qui lui échoit. Cette génération qui a, sans cesse, tourné le dos à l'histoire. Elle s'est toujours dérobée derrière des subterfuges que seuls les lâches sont capables de produire à satiété pour justifier leur manquement face à ses sempiternelles interpellations.
Aussi, monsieur Boukrouh, s'il fallait à tout prix faire endosser ce vil qualificatif à une catégorie, c'est bien à notre génération, notamment à son intelligentsia, qui n'a pas su faire montre de responsabilité. Vous en faites partie autant que moi. C'est derrière ce rempart que se terrent le désordre constitutionnalisé et le despotisme institutionnalisé que vous dénoncez. Nous sommes tous responsables devant l'histoire d'avoir accepté — car qui ne dit rien consent — l'accaparement de notre identité nationale par une minorité, de notre religion par une bande d'illuminés enragés, de notre histoire par une génération et de nos richesses par une oligarchie.
Pour ma part, je reste convaincu que nul n'a le monopole de l'amour de ce pays, autant les individus que les générations et que, s'il fallait reconnaître une pérennité, après celle d'Allah, c'est celle de l'Algérie. Œuvrons, par-delà nos différences et nos convictions, à sa sauvegarde, même s'il faille consentir le sacrifice suprême. Telles sont les limites que ceux que vous qualifiez de «lâches» sont prêts à franchir.
Je termine par une citation d'Albert Camus, que j'estime bien «coller» au sujet : «Pour qu'une pensée change le monde, il faut d'abord qu'elle change la vie de celui qui la porte. Il faut qu'elle se change en exemple.»
Lettre aux aînés
Mon introduction sera longue. Il ne s'agit point d'une option. La nature du sujet implique que l'on déroule le passé avant d'aborder l'avenir. Et, il est toujours difficile d'évoquer le passé sans heurter les sensibilités, notamment lorsqu'il s'agit d'énoncer des vérités, que d'aucuns ne manqueront pas de trouver blessantes…
Il l'est autant d'affranchir les autres, a fortiori ses aînés, tant l'ancien, de tout temps, a incarné dans notre imaginaire la figure du sage, et, chez nous plus qu'ailleurs, celle du sauveur, du libérateur. En notre for intérieur, nous sommes convaincus que nous leur devons beaucoup, si ce n'est tout.
Peut-être est-ce pour cela que nous cultivons à leur égard tant de révérence et déférence. Telle est notre histoire. Nous l'assumons et nous en tirons l'indicible fierté. Est-ce pour autant une raison pour leur taire la vérité ? Ce serait, à mon sens, trahir les commandements et les valeurs qu'ils nous ont eux-mêmes inculqués et que nous avons fini par faire nôtres.
Si je m'adresse à vous, en ce moment précis de notre vie nationale, c'est parce que je considère que l'heure de se dire autrement les choses est venue et qu'il est impératif de le faire aujourd'hui, car demain il sera trop tard. Notre pays est à la croisée des chemins.
Ceci implique des postures dont chacun de nous sera comptable devant l'Histoire. Nous nous devons d'agir pour que l'Etat soit ! Pour que l'Algérie soit ! Pour que la flamme qui naguère avait éclairé le chemin de la liberté pour notre peuple et donné corps à notre nation puisse continuer à le faire pour toutes les générations d'Algériens, présentes et à venir !
Cet appel, qui se veut davantage un cri du cœur que je lance à votre attention, vous, la génération de Novembre, celle de nos aînés, celle des artisans de notre passé, commandeurs de notre présent et potentiels garants de notre avenir, j'en suis convaincu, vous le comprendrez !
Pères et frères aînés,
Votre génération était là lorsque l'histoire l'a interpellée. C'est tout à son honneur. Elle a arrosé de son sang les graines de liberté que d'autres générations avant elle, depuis 1830, avaient semées à tout vent. Le 8 Mai 1945 les a fait germer, la Révolution du 1er Novembre 1954 les a fait éclore.
Œuvre titanesque, que les Pères fondateurs, visionnaires, ont, d'emblée, refusé d'en faire supporter le poids qui allait être le sien à la poignée d'hommes qu'ils étaient et à leur génération. L'auraient-ils fait, elle aurait été assujettie à la temporalité…
En toute humilité, ils l'ont voulue impersonnelle et intemporelle, pour qu'elle leur survive et que son esprit imprègne les générations à venir. En toute conscience, ils l'ont fait endosser au peuple. «Un seul héros, le peuple !» ont-ils décrété et il en a été ainsi.
La foi, l'engagement, l'abnégation et l'esprit de sacrifice, tel a été leur credo. Ils ont cru en leur cause au point de tout mettre à son service, leur jeunesse, leur vie et leurs biens. Ils se sont érigés en exemples. Connaissant profondément leur peuple, de l'exemple ils ont fait une véritable stratégie, l'essence même de cette grande Révolution.
Pères et frères aînés,
Toute Révolution est par définition féconde par sa dynamique historique et l'espoir du meilleur dont elle est potentiellement porteuse. Les géniteurs de la Révolution du 1er Novembre 1954 en ont fait, dans l'élan nationaliste et l'engagement sincère qui étaient les leurs, une œuvre grandiose, d'un grand dessein, transcendant les époques, les générations et les hommes.
Une entreprise de longue haleine, un héritage éternellement inachevé, que chaque génération qui le reçoit en legs, dans l'impossibilité de la parachever, était dans l'obligation morale de le passer, tel un relais, à la suivante, pour qu'elle le marque de son sceau avant de le transmettre à celle qui lui succède, pour en perpétuer l'esprit et la lettre. Ils l'ont imaginée en modèle de lutte d'un peuple pour sa liberté.
Ils l'ont conçue libératrice, fondatrice d'une nation, d'un Etat, d'un Etat-nation, à la fois libre, prospère, social et fondamentalement démocratique. Elle a transcendé leur dessein premier, pour devenir un modèle d'émancipation, d'espérances et d'édification pour tous les peuples victimes d'oppression et de déni. Elle s'est désormais inscrite dans la trajectoire de l'universel… de la pérennité.
Ces valeurs avaient façonné la nation algérienne et l'Etat national naissant. Elles ont constitué le socle idéologique du système politique de l'Algérie indépendante et largement contribué au maintien de l'équilibre social au lendemain de l'indépendance. Ce marquage révolutionnaire a été relativement saillant et n'a pas été sans déteindre sur le fonctionnement de l'appareil de l'Etat, toutes institutions confondues, notamment pendant les toutes premières décennies.
La collégialité dans la prise de décision – qui n'exclut nullement l'existence de divergences et de tiraillements internes – était de mise. Le «nous» subrogeait alors le «je» du tenant du pouvoir du moment. Les «qararna !» (Nous avons décidé !) résonnent encore dans l'oreille de ceux qui ont vécu cette période.
Et, s'ils s'en délectent encore, c'est parce que, systématiquement, l'action n'était pas sans suivre la parole. L'«esprit pluriel» s'imposait en culture dans le discours politique de l'époque au point où l'usage du singulier devenait problématique, voire appréhendé comme une expression de déviationnisme de la trajectoire révolutionnaire.
Il s'agit d'appréhender cette posture dans le contexte de l'époque où, notamment en Afrique, en Asie et dans le monde arabe, des leaders étaient portés aux nues… divinisés, pourrait-on dire ! En Algérie, nous les raillions tant la Révolution avait cultivé en nous l'esprit de la collégialité …
Dans notre imaginaire politique collectif, il n'y avait pas de place pour l'homme, quel qu'il soit… Notre sujet était idéologiquement pluriel. Les «Six Immortels», conscients du poids de leur œuvre et soucieux de la pérennité de ses effets, en avaient décidé ainsi et les dirigeants et le peuple algérien de l'époque s'y sont conformés.
Peut-être était-ce là l'une des raisons de la réussite de nos gouvernants dans les premières décennies de l'indépendance. En effet, cette période difficile, où tout manquait, n'en était pas moins féconde en réalisations, tant l'engagement de l'élite politique, par-delà le caractère anti-démocratique de son avènement, était total et ses convictions sincères.
Elle a su rendre le peuple partie prenante dans tout ce qu'elle a entrepris. En l'associant à ses choix, elle a su insuffler en lui l'espoir, qu'il lui a rendu en l'investissant de sa confiance et de son soutien indéfectible dans l'effort collectif de l'édification nationale, caractéristique indélébile de ces années.
Cette période a indéniablement fortement déteint sur le rapport des Algériens envers le pouvoir et l'Etat. Et, peut-être, est-ce là l'une des raisons qui font, qu'à ce jour, le peuple algérien continue à percevoir le premier à travers sa pluralité, et le second à travers sa dimension de puissance publique et, peut-être plus qu'ailleurs, celle de régulateur social.
Et, parce que les Algériens vivent l'Etat comme une émanation de leur Révolution, leur marge de tolérance par rapport aux manquements de ceux qui sont censés le servir est réduite.
D'eux, le peuple attend exemplarité, vertu et respect des valeurs. Ce peuple ne peut concevoir, encore moins tolérer, son Etat national atrophié, personnel, corrompu, défaillant ou absent. Ce sont là les exigences de tout grand peuple. Et, c'est parce que les peuples sont par définition réactifs qu'un grand peuple est en droit d'exiger de son Etat d'être à la mesure de ses aspirations.
Pères et frères aînés,
Ce serait faire preuve d'une impardonnable ingratitude que de ne pas reconnaître les saines ambitions que vous avez nourries à l'égard de ce pays et les réalisations portées à l'actif de votre génération. Devrait-on pour autant taire les déviances que notre pays est en train de vivre sans s'inscrire en faux avec les fondamentaux de notre Révolution, ceux-là mêmes que vos propres compagnons chouhada vous ont laissés en legs ? Si tel devait être le cas, le silence relèverait de la pure trahison.
Pères et frères aînés,
Autant nos vaillants martyrs se sont inscrits dans la postérité par le sacrifice suprême, autant la majorité de ceux qui ont contribué à la libération de ce pays se sont investis avec dévouement et abnégation dans le processus de son édification, autant une minorité, se prévalant de leur appartenance à cette honorable génération, par leurs agissements, donnent l'impression qu'ils s'inscrivent charnellement dans l'anhistoricité.
Ils s'érigent en éternels gardiens du temple, propriétaires exclusifs d'un récit national que le Mouvement national avait pourtant entamé avant de le transmettre à leur génération, pour, qu'à leur tour, ils en fassent de même avec leurs descendants. De ce récit, ils se sont emparés, par-devers la majorité silencieuse au sein de leur propre génération, pour perpétuer leur règne, dussent-ils transcender les lois de la nature.
Séduits par le seul pouvoir et emportés par le tumulte que produit l'orchestre des thuriféraires à leur adresse et l'ivresse que leur procure leur discours dithyrambique, ils ne se sont pas rendu compte que leurs carrières, après avoir érodé celles de leurs propres enfants, emboîtent celles de leurs petits-enfants qui, de plus en plus, cultivent le sentiment de ne pouvoir les remplacer un jour…
La trajectoire de leurs parents, sexagénaires et septuagénaires, mis souvent prématurément au rebut, est là pour les pousser au désenchantement. Désorientés et désespérés, ils prennent le chemin de l'exil, qui, diplôme en main, par le vol régulier, qui, nourri par le désespoir, par la harga dans une felouque de fortune !
Au lieu d'insuffler en eux l'espoir en un avenir meilleur, ils persistent à leur tenir le même langage que celui dont ils ont abreuvé leurs parents, partis à la retraite, convaincus, de guerre lasse, qu'ils étaient encore trop «jeunes» et que la chefferie, en toute légitimité, revenait à ceux-là mêmes qui les ont recrutés. Dans tout ce magma générationnel, c'est la persistance dans l'erreur qui pose problème beaucoup plus que l'erreur en soi. Qu'on en juge !
Pères et frères aînés,
A l'orée du soixantième anniversaire de l'indépendance et dans la perspective des joutes électorales de 2019, jouant sans retenue aucune les codes de l'histoire, nous voilà, peuple algérien dans toute sa splendeur, faire figure de Diogène le Cynique, ce philosophe grec, qui, en plein jour, sa lanterne à la main, parcourait les rues d'Athènes à la recherche de l'homme-providence.
Cette minorité, qui par ses déclarations intempestives sonnant la fausseté et ses agissements frisant l'indécence n'est pas sans altérer l'image de cette génération d'exception qui est la vôtre, a transcendé le pari de la mort, déifiant l'homme et réifiant Dieu, au motif d'une fidélité affichée qui cache mal les desseins des uns et des autres.
Le peuple n'est pas dupe, encore moins amnésique. Il connaît les siens. Il sait qu'ils seront, le moment venu, les premiers à crier haro sur le baudet et user de leur talent de laudateurs pour fustiger celui qui n'est plus et porter aux nues le nouveau maître de céans, en faisant mine de n'être en rien responsable de quelque passif que ce soit.
Contrairement à ceux-là, les Algériens authentiquement nationalistes sont convaincus que la terre qui a enfanté Gaïa, Massinissa, Jugurtha, Takfarinas, El Kahina, Lalla Fatma N'soumer, Abdelkader, les «Six Immortels», le million et demi de martyrs et ceux qui ont suivi leur voie pour que ce pays ne tombe pas dans les ténèbres du Moyen Age, et tous ceux qui se sont sacrifiés et continuent chaque jour à le faire, pour que cette nation soit, ne saurait devenir subitement stérile et qu'elle est tout aussi féconde de patriotes intègres, compétents et chérissant ce pays par-dessus tout. Ils sauront le défendre et défendre ses acquis, si nécessaires, au prix de leur vie. Des Hommes, l'Algérie en a enfantés et elle en enfantera !
Pères et frères aînés,
Ailleurs, sous d'autres cieux, face à des situations similaires, on dresse les bilans pour situer les responsabilités. Pour ma part, je ne parlerai ni de l'érosion de nos valeurs, ni du désespoir de notre jeunesse, ni de la fragilisation des institutions, ni de l'état dans lequel se trouve l'école algérienne, ni de notre système de santé avec le surgissement de pathologies relevant d'autres âges, de l'insalubrité de notre environnement, ni de l'insécurité à laquelle sont exposés quotidiennement nos concitoyens, ni du trafic et de la consommation de drogues de plus en plus dures, ni du phénomène de la harga, ni de la dépréciation historique du dinar face aux monnaies nationales de nos voisins – encore moins face au dollar ou à l'euro –, ni du taux de chômage, ni de l'inflation galopante, ni de la fuite des cerveaux, ni du fléau endémique de la corruption qui ronge notre société et nos institutions, ni du népotisme, ni de la fraude électorale, ni des restrictions des libertés individuelles, ni de l'effilochement du lien social, ni du déphasage générationnel qui place dos à dos gouvernants et gouvernés ; ni de la crise économique, ni de, ni de… Ma génération n'étant pas fondée pour le faire. Vous en avez décrété l'immaturité. J'opte pour le silence.
Pour autant, s'il est admissible de vous avoir laissés seuls juges et acteurs de tout ce que vous avez entrepris, il ne l'est point, pour ce que certains, d'entre vous, comptent entreprendre.
Il y va de notre présent, de l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants, autrement dit de celui de vos propres enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants qui risquent de payer les frais d'un choix qu'une minorité tente, si rien n'est fait pour l'en empêcher, de lui imposer, ouvrant les portes du pays à une crise dont on évalue mal l'ampleur.
Cette crise, dont nous vivons déjà les prémices, ne constitue pas une fatalité en soi. Et, qu'on se détrompe, elle n'est pas due à l'effondrement du système politique mis en place depuis l'indépendance. Elle est surtout due à l'incapacité – ou à la volonté – de ceux qui en ont été à l'origine, de lui avoir prévu un autre en substitution.
C'est le vide ainsi créé qui est en train de faire le lit de cette crise multidimensionnelle dont les contours, sans préjuger de ses retombées, se précisent chaque jour qui passe. C'est dire que la myopie politique, dont certains font preuve, est en soi dévastatrice !
Pères et frères aînés,
Les signes annonciateurs de l'épuisement de ce système sont pourtant là. Depuis plus de trois décennies, il n'a eu de cesse de donner les signes avant-coureurs de ses limites. Son sauvetage aurait été possible si votre génération avait pensé, à temps, à sa régénération intelligente et diligente en l'ouvrant à la jeunesse.
Il aurait été ainsi mis en phase avec son temps et adapté en conséquence, pour mieux répondre aux exigences de son environnement. L'option pour sa fermeture l'a mis hors temps et exposé à l'archaïsme qui a fini par le rogner. Entropique, incapable de se réformer et d'assurer sa propre régénérescence, il est mort de sa belle mort !
Cette minorité qui s'agite à tout vent est la seule à en ressentir encore le souffle et ce n'est certainement pas l'acharnement de ce qui lui fait office de vecteur idéologique, convaincu qu'il est que, parce qu'il a tenu, il tiendra, qui le ressuscitera. Arrivé désormais lui-même au terme de son histoire, il a perdu ses conditions de possibilité de quelque mobilisation que ce soit. Coupé de sa base et réduit à un appareil à la composante populairement contestée, il n'œuvre qu'à veiller un corps en totale décomposition.
Et, ce n'est pas la seule opacité qui caractérise ce système, qui entoure aussi bien ses acteurs que son mode de fonctionnement, qui conditionne le positionnement de ses défenseurs les plus zélés. C'est, fondamentalement, la rente dont il est le distributeur exclusif qui motive au premier degré ceux qui s'entêtent à vouloir le ressusciter.
La grande majorité considère, quant à elle, qu'il suffit d'identifier les acteurs de ce système, d'analyser les interactions qui s'y produisent, de déceler la nature et l'incohérence qui les caractérisent et d'apprécier les conditions dans lesquelles elles s'opèrent, pour se convaincre de sa finitude.
Pères et frères aînés,
Je reste fermement et intimement persuadé que tel n'était pas le dessein de votre génération. Néanmoins, bien que ce soit une infime minorité des vôtres qui en soit responsable, c'est à votre génération que l'histoire, dans son entêtement légendaire, fera endosser cet échec.
Si le mot est trop fort, vous êtes en droit légitime de le récuser. Si j'en use, c'est par défaut. Sinon, comment qualifier cette démarche suicidaire dont cette minorité, forte d'une logique dont elle est la seule à en apprécier le bien-fondé, est déterminée, non seulement à ne pas s'en départir mais, pire encore, à chercher à l'imposer au peuple ? Ses choix et ses points de vue font figure, elle les clame en axiomes que le peuple, à ses yeux, immature, est tenu d'accepter comme tels.
Ces égocentristes sont loin de se rendre compte qu'ils sont aux antipodes du courant éminemment nationaliste et qu'ils sont en train d'obérer les chances de l'Algérie d'être là où son histoire, sa géographie, ses ressources avérées et son potentiel stratégique la prédestinent.
Sont-ils conscients que, par ce qu'ils sont en train d'entreprendre, ils ne font rien d'autre que d'élargir, au point de le rendre infranchissable, le fossé entre l'Algérie et son environnement, accentuant dangereusement notre déphasage politique, social, culturel, scientifique, technologique et économique par rapport au reste du monde ?
La stratégie pour laquelle a opté cette minorité est celle du pouvoir et non celle de la gouvernance. Elle agit comme si les deux stratégies étaient inconciliables alors que, d'évidence, si la seconde est bien menée, elle n'est pas sans consolider ce qui la préoccupe en premier, le pouvoir.
En guise de gouvernance, elle use de la rente comme moyen privilégié de sa politique, corrompant délibérément les esprits et sapant par là même la valeur capitale sans laquelle aucun peuple ne peut se relever de sa condition première : l'effort. Elle a dispensé le peuple algérien du travail en contrepartie de ses applaudissements approbateurs et de sa prosternation devant le donateur.
Naguère rebelle, elle l'a asservi et perverti. Et, c'est non sans peine et serrement de cœur que nous le voyons verser dans le lyrisme pour déclamer les vertus du tenant des cordons de la bourse nourricière, lui naguère si fier. Ainsi, en se démenant à défendre son régime nourricier, elle a enfermé la société civile dans le carcan avilissant de l'approbation.
Ce faisant, elle a vidé la nation de sa substance créative et érodé ses capacités de réprobation et de résilience. Elle a inoculé au pays le conservatisme et l'immobilisme jusqu'à l'overdose. Plus est, par la marginalisation du peuple, elle en a fait un fardeau inerte dont l'Etat peine à supporter la charge. N'étant pas partenaire, il n'a de cesse de contribuer davantage à l'érosion de son autorité qu'à la raffermir.
Notre cohésion nationale est mise à rude épreuve. De notre patrimoine, nous en sommes dépossédés tant notre identité est happée par les forces centrifuges et nos valeurs, qui ont naguère fait notre force et tenu le pays debout contre vents et marées, vacillent. L'Algérie est sous l'emprise du doute.
Aucun domaine n'est épargné. La stagnation et le miasme, source de désespoir et de reniement, appréhendés comme fatalité, sont en train d'envahir notre imaginaire collectif. Et ce n'est pas sans angoisse, regret et amertume que nous assistons, impuissants, à des pays insignifiants nous tailler des croupières et jouer le rôle que le destin nous a pourtant si généreusement dévolu.
Pères et frères aînés,
Notre Patrie a besoin d'un souffle nouveau, de sang nouveau, d'alternatives courageuses que les anciennes recettes ne peuvent lui procurer. Elles ont montré leurs limites. Elles ont anémié la nation et mené le pays à l'impasse.
L'Algérie a besoin d'être mise en phase avec sa destinée et c'est en toute légitimité que son peuple aspire à un changement salvateur que seule une réelle rupture, sans reniement, est capable de lui apporter. Cette République a besoin d'une réelle refondation démocratique et d'une totale reconfiguration institutionnelle dans le moule d'un projet de société, dont le peuple aurait participé à la définition de la philosophie autant qu'à la mise en œuvre.
Il s'agit de refonder l'Etat national pour en rationaliser le rôle et rendre le fonctionnement de ses institutions authentiquement démocratique ; d'insuffler et de raffermir la culture citoyenne ; de placer le droit au centre des rapports entre citoyens et entre gouvernants et gouvernés ; d'élaborer et de mettre en œuvre une véritable politique territoriale équilibrée et inclusive ; de redresser, moderniser et transformer l'économie nationale pour la rendre réellement productive, compétitive, diversifiée et mettre fin à sa dépendance exclusive des hydrocarbures ; de réformer l'école pour en faire le véritable creuset de la citoyenneté et la rendre performante, moderne, ouverte sur la société et sur le monde ; de libérer les initiatives ; de rendre l'espoir à notre jeunesse et la réconcilier avec son «moi» national en encourageant sa promotion sociale et professionnelle et en lui facilitant l'accès aux postes de responsabilité, sans exclusive aucune, au vu des seuls critères de compétence et de performance ; de réformer le système national de santé ; de promouvoir la culture nationale ; de doter l'Algérie des attributs de sa puissance régionale pour qu'elle puisse assurer son intégrité et contribuer à la paix mondiale et, par-dessus tout, réhabiliter nos valeurs nationales sans lesquelles aucune action salvatrice ne saurait être envisagée. Telles sont les exigences du moment que seul un passage de flambeau entre générations dans un climat apaisé est à même de réaliser.
Car, dans un environnement aussi dangereux que volatil, où le danger mue en menace sans transition aucune, où la variable de l'incertitude s'impose comme constante, l'affronter avec pour seul viatique un passé, si glorieux soit-il, c'est exposer la nation à la disparition.
Pères et frères aînés,
Vous vous posez certainement la question sur les raisons de ma démarche et la rudesse du discours. Il s'agit d'un appel du cœur, que j'ai voulu direct, franc, sincère et loyal, en totale opposition avec ce dont vos thuriféraires vous ont habitué. J'espère, par son biais, éveiller en vous, à la veille de l'élection présidentielle de 2019 qui s'annonce d'une importance capitale, voire vitale, pour le pays, l'indispensable compréhension dont il vous appartient de faire preuve envers ce peuple que les feux du désespoir sont en train de consumer et, par là même, vous faire prendre conscience des retombées néfastes qu'un entêtement à vouloir lui imposer quelque choix que ce soit pourrait produire.
La construction ou la destruction d'un avenir désiré par les générations de vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, car c'est de ceux-là qu'il s'agit, dépendent de cette échéance et restent, dans une large mesure, attelées à votre niveau de conscience. De votre aptitude, de votre sens de la responsabilité, de votre capacité à vous assumer en tant que génération, dépend l'avenir de notre pays. Votre responsabilité historique est encore une fois, et plus qu'auparavant, totalement engagée.
Je reste convaincu que vous êtes les seuls, tant qu'il est encore temps, à pouvoir changer le cours des choses avant que le feu ne prenne. Vous êtes les seuls à pouvoir prodiguer vos sages conseils à ceux, parmi les vôtres, qui, disposant encore des clés pour une douce solution à cette grave crise multidimensionnelle qui s'annonce, sont à même d'éviter le pire à ce pays. Vous êtes les seuls à pouvoir les faire sortir de cette posture d'entêtement génératrice de violence. Vous êtes les seuls à pouvoir les convaincre de transcender leurs egos respectifs au profit d'une transition générationnelle pacifique du pouvoir.
Vous avez été les maîtres d'œuvre d'une Révolution qui a fait école, l'opportunité historique se présente – une ultime fois – à votre génération pour apposer son sceau pour l'éternité sur le parchemin de l'histoire de cette nation. Faites que ce soit dans le bon sens. Certains pays amis nous ont montré la voie, nous pouvons l'emprunter pour le salut de notre nation et… pourquoi pas, ne pas leur ravir l'exemple.
Le naufrage de l'Algérie ne peut être conjuré que par l'effort et la volonté et tous ses enfants. Plaçons l'avenir de nos descendants et le destin de l'Algérie par-dessus tout et, la main dans la main, amorçons l'indispensable refondation de cette Algérie, qui nous est à tous si chère.
Si vous êtes, en toute légitimité, en droit de vous prévaloir du monopole du combat libérateur, l'amour de cette Algérie, nous l'avons tous en partage ! Agissons ensemble pour la préserver !
Gloire à l'Algérie ! Gloire à nos martyrs !
Lettre au Frère Président Abdelaziz Bouteflika
El Watan du 06 décembre 2018
Si je m’adresse à vous précisément en ce moment par le biais d’une lettre ouverte, c’est que la situation le requiert. Je ne pouvais en effet faire taire davantage ces pulsions qui nourrissent mes insomnies, tant l’avenir de ce pays m’importe autant qu’à tout le peuple algérien. Il ne peut en être autrement eu égard aux perspectives qui se présentent et aux enjeux dont elles sont porteuses qui ne sauraient ne pas alimenter le débat.
Frère Président, il y a bientôt quinze ans, lors d’un entretien que vous aviez permis à l’occasion d’une séance de travail avec Votre Excellence, je vous ai parlé de la nécessité de la rupture et de celle d’investir le corps de la jeunesse de votre confiance… Vous aviez alors fait montre de réceptivité franche et de bonnes dispositions à l’égard de ce segment de la nation, sain et prometteur et de l’idée de changement.
Je vous le redis maintenant, dans d’autres circonstances et en d’autres termes, mais toujours avec la même conviction, parce que je persiste à croire obstinément que telle est la voie du salut pour ce pays. En 2012, votre discours, qui a porté sur la nécessité et l’inéluctabilité de la transition générationnelle m’avait alors donné espoir, comme à des millions d’Algériens, que l’ère du changement était enfin advenue. Vous étiez sincère et tel était le fond de votre pensée.
Vous l’auriez fait, le peuple en est persuadé, n’étaient les aléas de la vie… Ce sont ces arguments qui font qu’il soit fondé de refuser d’admettre que vous seriez, à quelque titre que ce soit, un obstacle au changement et ce sont les mêmes raisons qui vous poussent à vous opposer à ceux qui échafaudent des stratégies de pérennisation d’un règne dont vous-même aviez dénoncé les limites.
Le peuple, vos convictions, il les a faites siennes. Il se fait votre porte-voix, témoignant ainsi devant l’histoire que la revendication pour le changement, vous en avez été le précurseur.
Frère Président, vous avez assez fait pour ce pays pour lequel vous avez sacrifié votre jeunesse et, adulte, votre santé, pour qu’une minorité se serve de votre image, de votre passé et de l’affect populaire à votre égard pour monter des stratagèmes qui n’ont d’autre finalité que d’assouvir des desseins d’accaparement d’un pouvoir qu’elle sait hors de sa portée par les voies normales.
C’est là où se situe la déviance. Cela ne saurait se faire sans péril pour la nation, traversée qu’elle est par de graves incertitudes quant à son avenir et à son unité et, paradoxalement, plus que jamais déterminée à mettre à profit les joutes électorales de 2019, pour amorcer ce changement qui transcende les personnes et auquel vous aviez appelé. Cette aspiration à la rupture que recelait votre discours est désormais celle du peuple.
C’est dire que le peuple est en phase totale avec votre appel de Sétif et s’il s’en fait l’écho à la veille des élections projetées, c’est qu’il l’endosse comme cause. Telle est sa posture et, parce qu’il en est ainsi, il serait dangereux pour la stabilité du pays de ne pas en tenir compte. Vous avez toujours été à son écoute, je reste convaincu que vous demeurerez attentif à ses réactions.
Frère Président, vous méritez mieux que de servir de gué pour des aventuriers sans scrupules, rôle que certains, nullement représentatifs de ce peuple, semblent vouloir vous assigner. Votre passé vous place au-dessus de la mêlée. Votre destinée vous prédispose pour être ce lien, ce trait d’union historique, ce pont entre deux générations, celle qui a fait Novembre et de l’Algérie une nation et celle qui, imprégnée de son esprit, œuvre à en perpétuer le message.
Vous êtes le dernier de votre génération à présider aux destinées de ce pays. C’est dire que l’histoire vous a choisi et que l’honneur vous échoit, parmi tant d’autres de vos frères d’armes, pour que vous assigniez à la trajectoire de cette Algérie le sens que lui ont tracé nos valeureux chouhada, vos compagnons de combat. Faites qu’il en soit ainsi. Dans un ultime geste salvateur, empêchez qu’on détourne le fleuve de son lit et que votre état de santé ne soit pas mis à profit par certains pour mener ce pays vers le péril.
Il s’agit, Frère Président, d’user de l’autorité légale dont le peuple vous a investi et, surtout, de l’autorité morale et du capital de sympathie qui sont les vôtres auprès de lui, pour que la transition se fasse dans les règles, à travers des élections propres et honnêtes, seules à même d’éviter à notre pays un désastre potentiel.
Il est important aussi que vous sachiez que les manigances des uns et des autres qui, conviendrait-il de le souligner, n’auraient jamais eu lieu si votre état de santé était autre, font figure de livre ouvert aux yeux de ceux qui ont à cœur de voir l’Algérie réussir cette transition générationnelle sans heurts et qui œuvrent pour qu’il en soit ainsi.
Evitons à notre Algérie une redescente aux enfers. Elle a assez souffert depuis le recouvrement de son indépendance. Ses enfants sont en droit de vivre une rupture qui réponde à leurs aspirations, à leur rêve.
Frère Président, il y a des hommes qui sont prêts, en ces moments difficiles, à consentir le sacrifice suprême pour ce pays, pour que la trajectoire de Novembre reprenne son cours et que la rupture sans reniement se fasse. Ils sont déterminés. Et, parce qu’ils le sont, ce ne sont pas les menaces, voilées ou franches, qui les en dissuaderont.
Celles de ceux qui n’envisageant aucune distanciation par rapport au pouvoir, n’ont d’autres desseins que de s’en accaparer, le moment venu, par-devers la volonté populaire, pour l’exercer ad vitam au mieux de leurs propres intérêts, avant de le transmettre en legs aux leurs. Faites, Frère Président, tant qu’il est encore temps, que ce sacrifice ne soit pas pour le pire, mais pour le meilleur, celui de la renaissance de l’idée nationale, celui de l’espoir pour toute une jeunesse, celui du renouveau.
Frère Président, je me suis permis ce cri du cœur à l’adresse de votre honorable personne, à l’adresse du moudjahid que vous êtes, étant convaincu qu’il trouvera en vous l’écho attendu par ce peuple, parce que votre destinée vous a prédisposé pour être l’acteur, pour être ce pont vers ce monde meilleur auquel il aspire. L’histoire ne manquera pas de le porter à votre actif, parce que vous l’aurez écrite.
Faites-le, Monsieur le Président.
Salutations militantes.
Par Ghediri Ali , Général-major à la retraite
Ali Ghediri. Général-major à la retraite
Gaïd Salah face à une responsabilité historique
Watan du 25 décembre 2018
«Je ne pense pas que le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah puisse permettre à qui que ce soit de violer d’une manière aussi outrageuse la Constitution. Il n’est pas sans savoir qu’il est le dernier de sa génération et que l’histoire est fortement attentive à ce qu’il fait ou fera. Je reste persuadé qu’il sera au rendez-vous de l’histoire, comme il l’a été hier, alors qu’il n’avait que 17 ans.»
– Vous avez publié trois tribunes successives dans lesquelles vous vous êtes adressé aux «aînés, au frère Bouteflika…» Qu’est-ce qui a motivé ces interpellations ?
Depuis que je suis à la retraite et à chaque fois qu’il y a eu un événement qui m’a interpellé, j’ai tenté d’apporter mon point de vue. Il en a été ainsi lorsque la moudjahida Zohra-Drif Bitat a été attaquée d’une manière aussi violente qu’incorrecte.
J’ai pris sa défense. J’ai donné mon point de vue lors de l’incarcération du général Hocine Benhadid et également lorsque l’on s’est attaqué au DRS (Direction du renseignement et de la sécurité), non pas pour défendre des individus mais l’institution.
S’agissant des tribunes que vous venez de citer, je ne peux rester indifférent à ce qui se passe dans mon pays et sur la scène politique. Je fais partie des millions d’Algériens qui n’ont pas de pays de rechange. Et si je me suis exprimé, c’est parce que j’ai estimé que la situation est grave et requiert autant un avis qu’une prise de position de ma part.
Voilà ce qui a motivé mes appels. Pour ce qui est de l’élection présidentielle de 2019, je considère que, plus que toutes les autres précédentes, les joutes à venir sont d’une importance capitale, en ce sens qu’elles sont à la fois porteuses d’espoir et de péril.
Elles placent l’Algérie sur une ligne de crête, entre ubac, le côté sombre, et adret, le côté ensoleillé. Si nous arrivons à les organiser sans encombres, nous aurons réussi notre pari, à défaut, le pays risque gros. Mais je demeure optimiste.
– Pourquoi interpeller les aînés ?
Parce que j’estime qu’ils ont leur poids historique, affectif et culturel et qu’ils peuvent de ce fait influer sur le cours des choses dans le bon sens. Parce qu’ils sont censés être le relais du message du 1er Novembre 1954 et des valeurs qu’il incarne dans notre imaginaire collectif. Ils sont aussi empreints de la sagesse qui a été le trait dominant de cette génération.
J’entends par sagesse, cette culture qui a fait de la collégialité la marque de fabrique de la Révolution algérienne et qui n’a eu de cesse de déteindre sur notre système politique depuis l’indépendance jusqu’à un passé tout récent.
J’ai interpellé mes aînés, ou plutôt nos aînés, afin qu’ils usent de leur poids au sein de la société et du pouvoir pour appeler les uns et les autres à reconsidérer leurs positions et pour ne prendre en considération que le bien de cette nation, de ce pays, de ce peuple. Le bien de notre Algérie.
– Pensez-vous que l’interpellation adressée au président de la République trouvera un écho ?
Celle adressée au Président, c’était pour lui rappeler un engagement qu’il avait pris devant moi lors d’un entretien qu’il avait bien voulu m’accorder dans le cadre de mes fonctions.
Il m’avait alors semblé percevoir, à travers ses paroles, une volonté de changement au profit de la jeunesse du pays. Son rappel du discours de Sétif m’avait convaincu que telles étaient ses convictions.
Et je reste persuadé que s’il avait la plénitude de ses capacités physiques, il aurait peut-être opéré les changements qui s’imposent. Ce n’est plus un choix, mais une impérieuse nécessité, le seul à même d’espérer un sauvetage du pays.
– Mais, entre-temps il est demeuré au pouvoir en se présentant pour un 4e mandat. A-t-il changé d’avis depuis ou bien les dynamiques du pouvoir en ont-elles décidé autrement ?
Je ne veux pas revenir sur les conditions dans lesquelles il avait brigué un 4e mandat. Un proverbe bien de chez nous dit : «Celui qui revient sur ses pas s’épuise», aussi, je préfère focaliser sur l’avenir et comment l’envisager autrement, au moment où certains parlent d’un 5emandat. C’est cela le problème.
– Mais on a l’impression que cette question est évacuée du débat et on susurre l’idée d’un report carrément de la présidentielle…
Je dis à ceux qui sont en train d’œuvrer ou de manœuvrer pour qu’il y ait autre chose que la tenue d’une élection présidentielle dans les délais et conformément à ce que prévoit la Constitution : dans quel cadre s’inscrivent-ils ? Forcément dans un cadre anticonstitutionnel. Je considère qu’il serait dangereux pour l’Algérie d’entrevoir quoi que ce soit en dehors du cadre constitutionnel.
Il faut impérativement respecter la Constitution. Le pouvoir a été remis au président Bouteflika en 1999 dans un cadre constitutionnel, je ne pense pas que cela l’honorerait, historiquement parlant, de partir et de céder le pouvoir en dehors de ce cadre.
Que ceux qui parlent en son nom se posent la question suivante : si tel devait être le cas, qui va assumer cet échec politique ? Et, il s’agirait bien d’échec et pas d’autre chose.
Qui va l’assumer face à l’histoire ? Eux ou le Président ? Le pays a été sorti d’une décennie sanglante grâce à des sacrifices que les Algériens avaient consentis et le pouvoir lui a été remis en bonne et due forme, il lui appartient aujourd’hui de faire en sorte pour qu’on ne sorte pas du cadre constitutionnel, à défaut, deux décennies de règne n’auraient servi à rien.
Qu’on respecte la légalité et qu’on ne cède pas aux caprices des uns et des autres. Il y va de notre stabilité sociale et de notre image à l’international.
– C’est tout de même curieux, à moins d’un mois de la convocation du corps électoral, que rien ne laisse transparaître que nous sommes à la veille d’une présidentielle…
Le problème de l’alternance est devenu subsidiaire pour la classe politique au pouvoir. Ils ne l’envisagent qu’après épuisement biologique alors que dans les Constitutions de 1996 et de 2016, l’alternance se situe dans un cadre bien précis. Un cadre politique et non biologique.
Il y a une minorité qui considère qu’il ne peut y avoir d’alternance que lorsque l’actuel Président ne serait plus de ce monde. Ce n’est pas normal. Il faut que la raison prévale sur toute autre considération de quelqu’ordre que ce soit, personnel, clanique ou autre. Que ceux qui prônent la continuité ou le prolongement assument publiquement les retombées de leur obstination.
Et ce serait insulter leur intelligence que de croire qu’ils ne sont pas conscients du risque potentiel qu’ils feraient courir à la nation dans pareil cas. Lorsque j’entends certains affirmer que le peuple algérien est échaudé par la décennie noire et donc il ne peut recourir à la violence, je leur rappelle que les jeunes qui ont aujourd’hui moins de 30 ans n’ont pas vécu cette période.
– Y a-t-il un risque d’explosion sociale violente ?
Je ne le souhaite pas pour le pays. Mais j’estime nécessaire et vital de prendre en considération ce risque là. En politique, l’intention est variable, mais en tant que potentiel elle est constante. Le risque potentiellement est là.
– Quel regard portez-vous sur le pays sur le plan politique et géostratégique ?
Je voudrais répondre en parlant de ce que l’Algérie n’est pas. Elle aurait pu être une puissance régionale. Tout la prédestine à ce rôle.
Sa position géopolitique, son histoire, ses ressources naturelles, son potentiel humain. Elle aurait pu être cette puissance régionale qui aurait pu contribuer à la stabilité de toute la région, le Maghreb, le Sahel et la Méditerranée, être un Etat-pivot avec lequel les grandes puissances auraient pu compter dans le cadre de la sécurité globale. L’Algérie aurait pu être la locomotive économique de toute l’Afrique.
L’Algérie appartient à un ensemble régional où elle aurait pu – si elle avait transformé son potentiel en puissance – avoir une place de choix et imposer ses points de vue et contribuer de manière efficiente à stabiliser toute la région. Malheureusement, elle n’est pas du tout cela. Affirmer le contraire, c’est se voiler la face. Je ne suis pas de ceux-là, je suis réaliste et pragmatique.
– Est-ce à cause de son système de pouvoir qu’elle n’est pas ce qu’elle doit être ?
Pour moi, le système politique qui a fait fonctionner ce pays depuis l’indépendance, bon ou mauvais c’est selon, avait une certaine cohérence d’ensemble, il avait ses acteurs, son mode de fonctionnement, sa logique et une finalité. Ce que nous sommes en train de vivre dénote d’une manière flagrante la finitude de ce système.
Et ceux qui prétendent le contraire, je leur réponds que pour qu’il y ait système, il faut que ses attributs soient ; sans ces derniers, on ne saurait parler de système. Pour faire court, je dirais tout simplement qu’un homme, quel qu’il soit, ne saurait faire système. Je précise. Que le pouvoir qui a, volontairement ou non, cassé le système en place, est en soi louable.
Ce qui ne l’est pas, c’est de n’avoir rien prévu en substitution. Il a créé un vide. La crise que le pays est en train de vivre émane justement de ce vide. La cacophonie qui entoure l’élection présidentielle, les va-et-vient des uns et des autres et le désemparement qui caractérisent la scène politique nationale dénotent la légitimité des appréhensions qui nourrissent le débat sur la place publique.
– Pour nommer les choses, vous faites référence à trois hommes, qui sont le président Bouteflika, le général Toufik et le chef d’état-major Gaïd Salah. Le premier est en retrait en raison de sa maladie, le second est rentré chez lui, il reste le troisième…
Au-delà des personnes, ce qui a prévalu jusqu’à un passé récent, c’est le fonctionnement par solidarité générationnelle. Tant que le système avait ses trois pieds, il pouvait prétendre à un équilibre. Mais une fois qu’il n’a plus ses trois pieds, son équilibre est devenu bancal. Tout le reste n’est que conséquence.
– Dans ce dispositif à trois, il ne reste que le chef d’état-major, le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, comme seul pilier et c’est le seul que vous n’avez pas interpellé jusque-là. Son rôle sera-t-il décisif dans la période politique actuelle ?
D’après ce qui s’écrit et se dit, certains demandent un report de la présidentielle, d’autres, la continuité. Tous les schémas anticonstitutionnels sont mis sur la table. Connaissant de près le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, je me défends de croire qu’il puisse avaliser la démarche d’aventuriers.
Il peut être conciliant sur nombre de choses, mais lorsqu’il s’agit de la nation, de la stabilité du pays, là il redevient le moudjahid et reprend sa figure de maquisard. Je ne pense pas qu’il puisse faire le jeu de ceux qui sont nourris par des instincts autres que nationalistes.
Je m’interdis d’imaginer que le général de corps d’armée Gaïd Salah puisse permettre à ces gens-là de transcender ce qui est prescrit par la Constitution pour assouvir leur désir, leur instinct et leurs ambitions. Je ne pense pas qu’il puisse trahir sa devise qu’il ne cesse de nous répéter : «Le pays avant tout.»
– Vous lui adressez là un message, une interpellation forte ?
J’exprime un sentiment profond. J’ai servi sous ses ordres pendant de longues années. L’Algérie lui est chevillée au corps. Il ne saurait la laisser choir entre les mains de gens qui n’ont d’autres desseins que de sauver leur tête, en se servant de l’institution dont il assure le commandement.
Je peux aussi affirmer qu’il recèle suffisamment de bon sens et surtout de patriotisme et qu’à ce titre, d’instinct, il ne saurait terminer toute une vie consacrée au service de la nation pour sortir de l’histoire par la petite porte, rien que pour faire plaisir à des aventuriers dont l’unique objectif est de rester au pouvoir et de profiter de la rente.
– Il est le garant de la Constitution, le dernier rempart ?
Au point où en sont les choses, il reste le seul, en tant que chef de l’armée. Il pourrait s’inscrire dans l’histoire. Il ne pourrait pas laisser l’armée faire le jeu d’un clan au détriment du pays. Il ne le ferait pas. Je crois pouvoir dire que s’il lui advenait de faire intervenir l’armée, c’est pour consolider les acquis démocratiques en mettant en place un dispositif à même de garantir un scrutin transparent.
Seule l’armée, en l’état actuel des choses et face à la déliquescence des autres institutions et au conditionnement dans lequel est mis l’administration, serait capable d’empêcher les uns et les autres de toucher aux urnes pour frauder et faire passer leur candidat. Je reste convaincu que le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah ne permettra à qui que ce soit de violer d’une manière aussi outrageuse la Constitution.
Il n’est pas sans savoir qu’il est le dernier de sa génération et que l’histoire est fortement attentive à tout ce qu’il fait ou fera. Je reste persuadé qu’il sera au rendez-vous de l’histoire, comme il l’a été hier alors qu’il n’avait que 17 ans.
Ahmed Gaïd Salah connaît finement les hommes. Malgré tout ce qu’on peut raconter sur sa personne, il demeure un moudjahid. Ne serait-ce que sur ce point précis, il mérite la confiance de tous ceux qui ont à cœur de voir l’Algérie réussir son pari.
– L’affaire des 701 kg de la cocaïne et ses conséquences sur les appareils sécuritaires avec des limogeages n’a-t-elle pas impacté l’image de l’armée ?
Jamais. L’armée n’est pas responsable de cette grave affaire. Il faut que la justice fasse son travail et que l’enquête aboutisse à des conclusions pour situer les responsabilités.
Je ne peux pas anticiper sur le travail de la justice. Cependant, cette affaire de cocaïne déstabilise le pays. Elle est d’une extrême gravité. La drogue et la corruption sont une menace pour la sécurité nationale du pays.
– Parlons justement de sécurité nationale, l’Algérie est-elle réellement menacée parce qu’entourée de frontières instables et hostiles ?
La menace est réelle, tangible et elle se manifeste. Le danger est potentiel, il couve. A partir du moment où notre voisinage est instable, il faut redoubler de vigilance. De ce point de vue, l’armée est en train de pleinement jouer son rôle.
Mais si l’Algérie se portait mieux politiquement et économiquement, la charge sur l’armée serait moindre. Je termine par vous dire à ce propos que notre armée est véritablement moderne. Très peu d’armées dans notre environnement régional peuvent égaler la nôtre en termes de potentiel humain.
L’Algérie a formé tous azimuts, et ce, depuis la Révolution. Nous avons d’excellents officiers et de valeureux soldats. Notre armée peut prétendre au titre d’armée professionnelle. Disons que ce pari, l’armée l’a gagné, il lui reste l’engagement démocratique.
Ali Ghediri répond à Gaïd-Salah et explique pourquoi il ne se retire pas
mars 7, 2019
Par Houari A. – Le candidat à la présidentielle Ali Ghediri a réagi aux discours du chef d’état-major de l’ANP à travers un «discours» adressé au «peuple algérien». «Je suis résolu à aller jusqu’au bout pour la rupture et pour l’instauration de la deuxième République», a asséné le général à la retraite, dont l’intervention contenait de nombreuses insinuations.
«Le retrait et l’abandon du navire qui coule ne font pas partie de ma culture», a déclaré Ali Ghediri, en réaction, sans doute, à la décision de deux éléments importants de son staff, son directeur de campagne, Mokrane Aït Larbi, et l’animatrice du mouvement Mouwatana, Zoubida Assoul, de se séparer de lui. «Les batailles perdues sont celles qui ne sont pas menées», a argué le candidat sur un ton militariste, estimant que «la bataille pour le changement a commencé» et que «les prémices de la victoire commencent à poindre à l’horizon».
Répondant à Ahmed Gaïd-Salah sans le nommer, l’ancien directeur central au ministère de la Défense nationale a soutenu que «les menaces brandies par certaines parties sont obsolètes» et qu’«elles visent à permettre aux artisans du quatrième mandat de se maintenir sous la férule d’un Président malade et de continuer d’agir comme s’ils étaient les tuteurs de la nation». L’allusion de Ghediri à son ancien chef hiérarchique est claire lorsqu’il ajoute que «l’opinion des individus ne représente pas forcément celle des institutions». «Le peuple est la seule source de légitimité de tout responsable, quelle que soit l’institution qu’il dirige», a-t-il dit, dans ce qui semble être un dangereux appel à la désobéissance.
Revenant sur sa décision de se maintenir dans la course «avec ou sans Bouteflika», Ali Ghediri a affirmé qu’il «respectera» la décision du peuple. «Ma décision de me présenter à la présidentielle est dictée par ma conviction que ce régime est corrompu et qu’il doit disparaître», a-t-il affirmé, sans que l’on comprenne si cela signifie qu’il pourrait se retirer si le peuple le lui demandait. «J’ai dit textuellement lors de ma toute première conférence de presse que c’était soit moi, soit le système», a-t-il ajouté, tout en précisant qu’il «demeure fidèle à cet engagement».
Ambiguïté voulue ou discours mal rédigé ?
















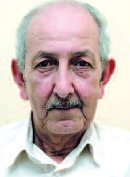 On le décrivait, à l’époque du coup d’Etat de 1965, comme un dandy plein de fatuité qui plastronnait dans un conseil de la révolution austère.
On le décrivait, à l’époque du coup d’Etat de 1965, comme un dandy plein de fatuité qui plastronnait dans un conseil de la révolution austère. 













































